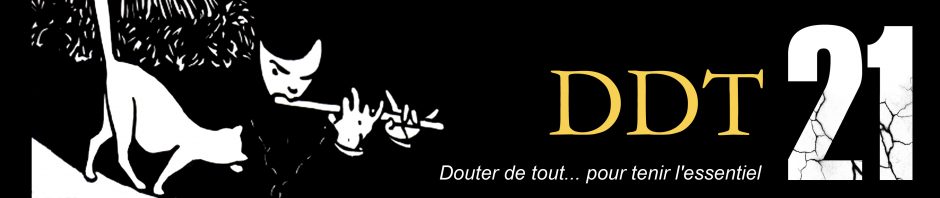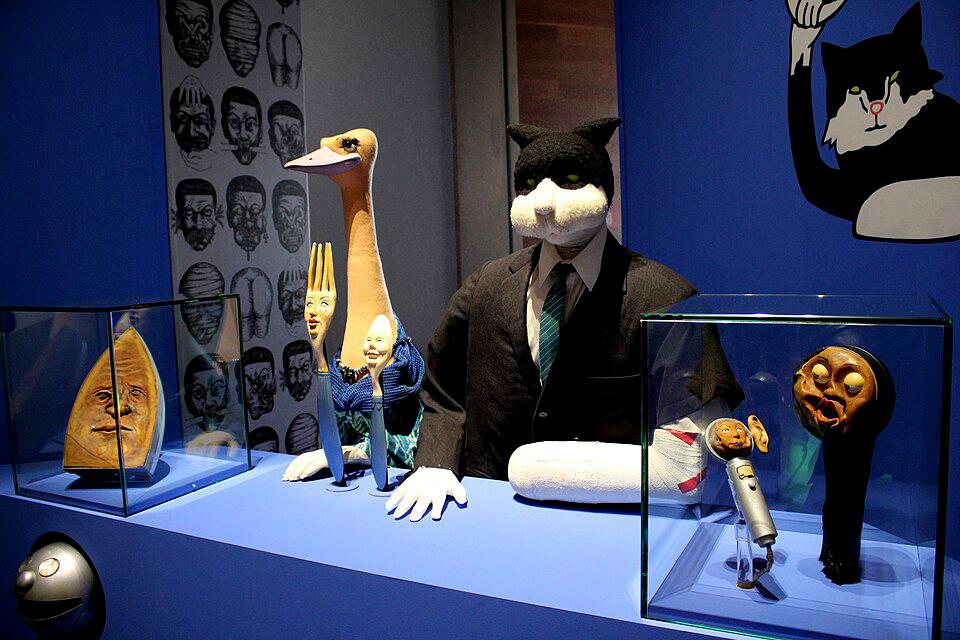Tirer le fil…
entre automne moscovite
et digressions parisiennes
« À bord du tram rouge un voyou et une fille farouche
voyageaient – direction nulle part. »
Boris Ryji
Il est des livres que, paraît-il, il vaudrait mieux ne pas lire ou, sinon, s’abstenir de les évoquer ; nous y reviendrons. En lire une recension est sans doute moins compromettant ; il faut l’espérer, car c’est ici le cas. Essayez donc.
Je vais aborder Vu de Russie de Thierry Marignac, ouvrage paru à la Manufacture de livres au printemps 20251 : le récit que fait cet auteur de polar, autrefois qualifié par Libération de « personnage un peu sulfureux », d’un automne passé en Russie, dans « le camp ennemi », à discutailler et boire des coups avec d’anciennes et de nouvelles connaissances. La chronique mérite le détour car elle nous livre, sans sombrer dans la caricature ou la bête binarité, un fort instructif éclairage sur la manière dont une partie des Russes vit et perçoit la guerre d’Ukraine2.
Certaines périodes étant plus propices aux digressions spatio-temporelles que d’autres, c’est très volontairement que je me suis d’abord laissé emporter vers des sujets a priori fort éloignés du Don et de la Neva, tels que les années Mitterrand ou la montée de l’extrême droite et l’antifascisme, pour, in fine, alunir en poésie russe post-soviétique. J’espère qu’il ne m’en sera pas trop tenu rigueur… Et puis qu’importe !
FACE A / FRANCE (années 1980)
« Je ne suis pas un journaliste de gauche :
je ne dénonce jamais personne. »
Guy Debord
On le comprendra, le fil rouge le plus visible permettant ces digressions n’est autre que cet auteur, Thierry Marignac. À l’occasion d’une réédition, j’avais lu Fasciste, son roman le plus connu et, plus récemment, Photos passées, son très bel ouvrage à teneur autobiographique ; mais pour cette recension, je me suis plongé dans nombre d’interviews accordées par l’auteur de 1988 à nos jours. Le personnage est assez surprenant : ovni littéraire un peu cabossé, style ancien punk – peut-être un brin mods, mais en tout cas bien « trop dandy pour porter des épingles à nourrice dans le nez » –, ancien tox, appréciant pourtant la fréquentation de nationalistes3 qu’on imagine proprets, polis et issus de bonnes familles, mais qui ne le sont pas toujours.
Il a vingt ans en 1978. À cet âge, Thierry Marignac a déjà une sérieuse expérience de la défonce et de l’errance urbaine, en particulier dans le Paris punk du XVIIIe arrondissement. Un an plus tard, il décide de décrocher de la came pour se mettre à écrire. En attendant, pour gagner de l’argent, il travaille aux éditions du Dernier terrain vague qui publient alors de très chouettes bouquins de Cathy Millet, Marc Caro ou Phil Casoar, et devient ensuite pigiste, notamment pour Libération et Actuel. Loin d’être idéal pour lui comme pour pas mal de jeunes gens qui détestent leurs aînés de la génération de Mai 68, du moins ceux qu’ils croisent, les socialistes et les anciens gauchistes passés du col Mao au Rotary, ceux qui se partagent les places et les postes au sein de l’industrie médiatico-culturelle puis, à partir de 1981, au sein de l’État : « Notre dégoût, notre mépris de petits frères devant la morgue péremptoire des révolutionnaires d’hier, aujourd’hui dans le camp des nantis et des gestionnaires, était sans mesure […]. L’exemple fourni par la plupart des soixante-huitards était une cure radicale des illusions. Ils avaient fait – prouesse philosophique – du reniement une profession de foi. Plus ils avaient été militants idéalistes dans leur jeunesse, plus ils étaient cupides à l’âge adulte, présentant, dans leur dialectique paradoxale, la rapacité et le carriérisme comme un signe de maturité. »
C’est dans ce cadre, en 1981, qu’il fait une rencontre déterminante. Le voici qui réalise l’interview d’un certain Édouard Limonov4, auteur tout juste débarqué de New York pour discuter avec Jean-Jacques Pauvert de l’édition de son premier roman, Le poète russe préfère les grands nègres5 ; l’écrivain punk – il adopte ce terme plutôt que celui de dissident alors trop à la mode – va connaître un certain succès littéraire et devenir en quelques années la coqueluche de l’intelligentsia parisienne tendance gauche caviar, mais pas seulement, puisqu’il aurait été classé en 1986 par le magazine Elle comme l’une des cinquante personnalités préférées des Français6 ! S’agit-il pour le jeune journaliste du premier contact avec le monde russe ? En tout cas, le contact fait plus que bien passer, les deux hommes deviennent amis et le resteront jusqu’à la fin. Il serait tentant d’ajouter ici quelques anecdotes, tel le mariage entre Thierry Marignac et la compagne de Limonov, la mannequin-chanteuse-poétesse Natalia Medvedeva… afin qu’elle obtienne un permis de séjour, mais non : être raisonnable. Nous recroiserons toutefois la trajectoire peu conformiste de l’écrivain russe, inévitablement.
Être raisonnable, par exemple préciser le contexte, celui des années 1980 qui ne commencent en réalité que le 10 mai 1981 avec l’élection à la présidence de la République de François Mitterrand7. Un bref espoir pour les travailleurs, suivi deux ans plus tard par la « trahison » de la rigueur, une fatidique année 1983 qui, symboliquement, marque un tournant pour la France et la social-démocratie. À ce moment du récit, il nous semble important de signaler au lecteur, ou de lui rappeler, qu’il ne s’agit pas de la même France, mais de « la France d’avant », une France que certains, plus jeunes, auraient du mal à imaginer, celle d’une époque qui se caractérisait par la présence en kiosque d’Actuel (troisième série) et de Métal Hurlant (période Dionnet), la lutte armée (Action directe entre beaucoup d’autres), les attentats (en pagaille), les braquages (en pagaille), les squats (forcément en pagaille), l’Autonomie (sur la fin), le vinyle et la K7 (en force), Taxi Girl (encore un peu), le rock alternatif (au début), les Bérurier noir (premier concert à l’Usine de Pali-Kao), la projection en salle de Mortelle randonnée (Claude Miller) et de Pauline à la plage (Éric Rohmer), le Sida (au début), les meurtres racistes (à leur paroxysme)8, la montée du chômage (au début) et celle du FN (au début). En 1983, Michel Houellebecq entame une prometteuse carrière dans l’entreprise d’informatique Unilog, mais personne ne s’en rend compte. Un autre monde.
Un Mai 68 à l’envers ?
« Charles-Henri ressemble à un loubard de banlieue. »
On évoque souvent le tournant de 1983 mais, en réalité, la politique de relance keynésienne, dite relance Mauroy, est abandonnée dès janvier 1982 ; cinq mois plus tard est même adopté un plan d’austérité présenté comme provisoire. Ce n’est qu’après les élections municipales de mars 1983 (catastrophiques pour la gauche, encourageantes pour le FN) que le gouvernement confirme son orientation rigoriste et la mise en œuvre de mesures antisociales9. La France étant alors en grande difficulté économique, ce choix est fait pour préserver la place du franc au sein du SME (le Système monétaire européen) et ne pas compromettre la construction européenne10. Le moment est historique pour la gauche : le PS reconnaît explicitement qu’une rupture avec le mode de production capitaliste est désormais impossible.
Pour les gestionnaires de l’État, l’année commence d’ailleurs mal, avec de puissantes grèves des ouvriers immigrés de l’automobile, chez Talbot ou chez Renault – pour faire diversion, Gaston Defferre, ministre de l’Intérieur socialiste, y dénonce les agissements « d’intégristes et de chiites » (nous sommes quatre ans après la révolution « islamique » d’Iran). S’y ajoute un mouvement des étudiants en médecine pour des revendications spécifiques, puis une grogne dans les facs pour des questions de carences budgétaires11.
C’est le moment que choisit le ministre de l’Éducation Alain Savary pour présenter au Conseil des ministres un projet de réforme des universités visant à adapter le système universitaire aux nouveaux besoins du capitalisme français :
« En 1983, la société prospère en expansion continue est mourante dans une profonde crise économique et le capital doit pour se survivre dans son cadre national se moderniser et se rationaliser encore plus. […] C’est la tâche du gouvernement social-démocrate d’essayer de forger les outils pour le capital et de faire couler le plus possible de plus-value vers les secteurs industriels qui ont une soif inextinguible de capitaux. […] Les lois dont nous avons parlé cherchent à réduire [le nombre des classes moyennes] et en même temps à diriger vers l’industrie le flot de techniciens qualifiés dont elle a autant besoin que de capitaux12. »
Droite et gauche divergent quant à la manière de sélectionner les élites. Si le ministre déclare que « la démocratisation de l’éducation est le meilleur moyen de parvenir à une sélection de dirigeants hautement qualifiés dont le pays à besoin », certains étudiants et enseignants contestent la suppression de la sélection à l’entrée de l’université qui en abaisserait le niveau.
En avril, alors que les étudiants de médecine sont toujours en lutte, un mouvement de grève commence à prendre de l’ampleur dans les facs de droit, de sciences éco et dans certaines grandes écoles, mais son orientation politique s’avère pour le moins inédite.
Si la gauche étudiante, divisée en chapelles concurrentes communiste, socialiste et trotskistes, est embarrassée et ne critique que très modérément le projet, l’opposition de droite est en pointe dans ce mouvement, en particulier les jeunes du RPR via l’UNI, ou les jeunes giscardiens. Mais ce qui surprend peut-être davantage, c’est la présence d’organisations d’extrême droite que beaucoup imaginaient disparues avec la victoire de la gauche, FN, PFN13, mais surtout le GUD qui, à l’époque, se présente aux élections universitaires et dispose de délégués dans certaines coordinations étudiantes. Les manifestations se terminent fréquemment par des affrontements avec la police qui, à Paris, utilise les pelotons de voltigeurs motorisés (ceux qui trois ans plus tard causeront la mort de Malik Oussekine). Notre jeune journaliste, Thierry Marignac, est dans le secteur, il couvre le mouvement pour une radio de la région parisienne, interviews de militants, suivi des manifestations, etc. Le 24 mai 1983, Jack Lang, circulant en voiture, est reconnu et molesté par des manifestants ; le ministre de la Culture les décrira comme « des fascistes utilisant des méthodes nazies » (sic)14. La presse s’interroge alors sur la possibilité d’un « Mai 68 à l’envers »…
« Les plus actifs dans cette lutte furent les étudiants des disciplines ouvrant encore récemment aux professions lucratives dites libérales essentiellement les étudiants en droit et des professions médicales. […] cette opposition n’était pas du tout unie ; elle se divisait suivant des options politiques du moment qui masquait mal une communauté d’intérêt quant au maintien de privilèges de classe. Certains jours on vit trois manifestations distinctes : une de droite, une de gauche et une neutre. […] Tous ceux qui se sont trouvés impliqués dans ces luttes du printemps 1983 se rattachent soit par leurs origines, soit par leurs espoirs, soit par leur appartenance présente aux classes moyennes qui en France constituent des classes hypertrophiées et largement privilégiées. Globalement, leur action est une résistance à une prolétarisation : c’était aussi une des causes du combat étudiant en 196815. »
Le GUD, qui depuis 1981 connaît un déclin certain, y compris dans son fief d’Assas, atteint avec ce mouvement le point culminant de sa popularité et de son influence, notamment du fait d’une importante couverture médiatique. Une période courte mais presque mythique pour une génération de nationalistes et de fascistes, d’autant que leur jeune leader à l’allure bonhomme, Charles-Henri Varaut, meurt dans un accident de la route quelques mois plus tard16. Mais les nationalistes doivent aussi affronter dans la rue des militants d’extrême gauche et des autonomes :
« Il y a eu deux positions : une partie du mouvement, et encore, c’est difficile de dire un mouvement, parce que c’est pas beaucoup de monde et c’est déjà le bordel : une partie des gens, qui allaient faire les barricades, qui disaient : “Droite, gauche, on s’en fout : puisque de toute façon on va bien faire des barricades avec des abrutis de gauche qui sont nos ennemis, pourquoi on irait pas faire des barricades avec des abrutis de droite qui sont nos ennemis ? C’est de la révolte…” C’était une tendance. Moi, j’étais dans une autre tendance où on allait les éclater. Et, effectivement, on a attaqué ces manifs-là, on a fait des carnages. Il y avait deux groupes : ceux qui étaient plus du côté des situs qui disaient “Faut y aller”, et ceux qui se disaient fondamentalement antifascistes : c’était nous. Et nous on tapait dans le tas : on leur balançait des cocktails Molotov dans la gueule. Attaquer une manif au cocktail Molotov, c’est assez méchant17. »
En cette époque fulminante, il est d’ailleurs des « antifascistes » qui, ne connaissant pas encore les réseaux sociaux, s’affairent dans le concret ; pour ne prendre qu’un exemple, le 23 mai 1983, une explosion fantastique ne laisse pas une brique du siège parisien du PFN, boulevard de Sébastopol.
Ce mouvement du printemps 1983 est assez peu connu et étudié, absent des manuels militants ; certes du fait de sa faible ampleur et de son échec, mais aussi, on l’aura compris, par ses caractéristiques politiques qui lui interdisent d’être rangé dans la case « grèves étudiantes » de la grande histoire du mouvement ouvrier18. Comme souvent, plutôt que d’étudier la chose, on préfère la glisser sous le tapis. Ce premier mouvement « de jeunesse » s’opposant à un pouvoir socialiste ne passe toutefois pas inaperçu ; à l’époque, certains avaient déjà constaté une dépolitisation grandissante des étudiants, mais ici c’est toute la société qui découvre avec stupeur que la jeunesse ne se reconnaît pas mécaniquement dans « la gauche ». Au printemps 1983, Brice Couturier, militant maoïste converti à la social-démocratie, se préparant à être coopté à France Culture par Laure Adler, met la dernière main à un livre sur la jeunesse et s’inquiète : « Désormais identifiée au pouvoir, cette gauche est jugée sur ses seuls résultats concrets, sur la manière dont le courant passe ou ne passe pas. Or, il me semble que les malentendus se sont suffisamment accumulés pour qu’il soit opportun de tirer la sonnette d’alarme. Si les socialistes venaient à perdre la jeunesse de ce pays, quel espoir pourrions-nous encore concevoir pour l’avenir19 ? »
La gauche, ne pouvant désormais ni concrétiser ses promesses électorales ni satisfaire les revendications des travailleurs, va devoir, si elle souhaite rester au pouvoir, se montrer innovante en stratégie comme en rhétorique.
Fascistes !
« Vous aussi, vous portez sur vous
le romantisme suicidaire de la race. »
En ce printemps 1983, certains observateurs remarquent que le gouvernement ne s’active guère pour entraver l’éclosion d’un mouvement aux sensibilités droitières. Le « danger fasciste » tombe, il est vrai, à point nommé.
On le sait aujourd’hui, le projet politique auquel François Mitterrand œuvre depuis un an vise à diviser l’opposition de droite trop menaçante ; pour cela il s’agit tout bonnement de favoriser la croissance du FN – un parti qui jusque-là végète à 0,2 % des voix aux élections nationales – en facilitant l’accès aux médias de son chef, un certain Jean-Marie Le Pen20. Favoriser mais tout en diabolisant, et donc, deuxième effet de la manœuvre, rendre impossible une union de la droite ; troisième effet, remobiliser les électeurs de gauche dans un combat antifasciste qui leur fait accepter / oublier le tournant de la rigueur. Lors des municipales de mars 1983, on voit le FN atteindre les 10 % dans certains bureaux de vote ; en octobre, une alliance RPR-FN emporte la mairie de Dreux ; au même moment, une marche pour l’égalité et contre le racisme dite « Marche des beurs » part de Marseille (elle sera hautement instrumentalisée par le pouvoir). En juin de l’année suivante, lors des élections européennes, si la gauche s’effondre, le FN triomphe avec 11 % des suffrages, faisant jeu égal avec le PCF. S’appuyant sur le raz-le-bol d’une partie de la jeunesse, le PS crée en octobre 1984 l’association SOS Racisme, tandis que quelques radicaux fondent le SCALP pour s’opposer physiquement, dans la rue, aux fachos21.
Dès lors, mis à part quelques vagues projets culturels ou sociétaux présentés comme progressistes car en rupture avec les habitus de « la France d’avant », la gauche n’a pour seul pilier que l’antifascisme ; par nature interclassiste, « le pire produit du fascisme », selon la formule attribuée à Bordiga, va s’avérer jusqu’à nos jours diablement pratique pour défendre les intérêts du capitalisme hexagonal (est-il ici nécessaire de développer ?). Un quart de siècle plus tard, Lionel Jospin, qui fut premier secrétaire du PS et l’un des proches du président durant le mitterrandisme, reconnaît que « tout antifascisme n’était que du théâtre, il n’y a jamais eu de menace fasciste ».
Il y eu pourtant des fascistes. C’est semble-t-il en couvrant le mouvement du printemps 1983 que le journaliste Thierry Marignac fait sa rencontre avec l’extrême droite parisienne, un milieu politique qui – l’idée va mûrir progressivement – sera le cadre de son premier roman. Afin de se documenter, il se plonge ensuite dans une « assez longue enquête », en immersion nocturne dans les bars de fachos de Paname, notamment Le Sens du devoir (LSD), rue des Lombards, où se croisent divers militants, (ex–)militaires ou soldats de fortune. Pour se documenter, certes, mais aussi pour le plaisir qu’il prend à leur fréquentation, eux qu’il trouve si « vivants » : « Je m’entends souvent très bien avec les gens d’extrême droite parce que j’estime qu’ils sont bien plus “libertaires” que ceux de gauche, gardiens vigilants d’une morale insupportable22. »
Provoc, certain d’être à contre-courant du flot de production de « l’église gauchiste du polar », et croyant donc possible de s’y faire remarquer, Thierry Marignac publie Fasciste en 1986 chez Payot : journal sans illusion d’un militant d’extrême droite (un gars fort, viril, cultivé et politiquement structuré), à la première personne, description très réaliste de son activité et de ses frustrations, rudement froide mais, surtout, sans jugement moral… Quarante ans plus tard, on peut le lire comme un roman historique, mais à une époque où les gens biens arborent un badge de SOS Racisme, c’est pour le moins hérétique23. Refusant malgré les conseils d’effectuer la moindre contrition antifasciste, voici le primo-écrivain désormais tricard en milieu littéraire.
Mis à part le coup de poker éditorial, que cherche le jeune auteur ? À convaincre de la justesse d’une cause impie ? Il ne cache certes pas ses sympathies loin à droite, et lorsqu’un journaliste cherche à savoir s’il est « un fasciste honteux ou un anarchiste de droite », il n’hésite pas à répondre : « Si j’étais fasciste je ne vois pas pourquoi je le cacherais. ». Ceux qui, à droite, tentent de le recruter restent sur leur faim ; il déclare d’ailleurs ne pas être du genre à s’engager en politique, car pas du genre à y croire… Interrogé en 1988 par un journal d’extrême droite, il précise : « Ce qui m’a poussé à écrire ce livre, c’est l’intérêt que je porte aux différentes formes de la passion politique. Je considère que c’est une des dernières formes d’exaltation réelle qui existe dans une vie moderne écrasée par le matérialisme occidental. La passion est à mon sens un objet romanesque, presque religieux. [En 1973], il aurait été intéressant d’écrire l’histoire d’un terroriste des Brigades rouges, aujourd’hui c’est celle d’un activiste de la droite révolutionnaire que j’ai choisi de raconter24. »
Un quart de siècle plus tard, il confirme qu’il s’agissait pour lui de « montrer un autre genre de désaxés […], ceux qui ne rentrent pas dans la politcorrectitude de l’universalité banalisante, parce qu’ils ne portent pas le label “victimes” ».
Aujourd’hui, certains le questionnent sur l’évolution de l’extrême droite comme s’il était un expert du CNRS, mais il n’est qu’un amateur, du coup son point de vue n’est pas sans intérêt :
« Ça n’a plus rien à voir, à cause de la fin de la guerre froide. Quand j’ai publié le bouquin, l’URSS existait encore, on était en plein manichéisme. Après ça, la vision du monde a totalement changé. La Nouvelle droite a découvert Marx. Ils ont complètement changé leur rhétorique. Si mes copains qui sont morts aujourd’hui se réveillaient maintenant, ils seraient très étonnés de voir que la gauche est atlantiste et la droite pro-russe. Ceci dit, il y a quand même des choses en commun. Mais en se banalisant, le Front national se délaye au niveau des valeurs, opère des alliances impensables à l’époque. Donc s’il y a une filiation, tout a quand même énormément changé. Aujourd’hui, le FN fait des tas de références à de Gaulle : à l’époque, ç’aurait été impensable. Même les références à la littérature anar de droite, Chardonne, Drieu, de Roux, ne sont plus à l’ordre du jour maintenant. Les enjeux n’ont plus rien à voir. L’islamisme en 1985, à part l’Iran25… »
« Les courants les plus à droite aujourd’hui sont beaucoup plus importants en nombre qu’ils ne l’étaient à l’époque, mais aussi beaucoup moins subversifs, ce qui est logique, et était déjà annoncé dans la chute de mon bouquin : la nécessité d’être respectable. Je ne sais pas comment se perçoit la droite nationaliste de nos jours parce que je ne m’y intéressais que pour écrire mon roman, et je n’ai pas suivi. Je crois qu’ils sont en pleine confusion culturelle, suite à leur succès politique26. »
Si Fasciste n’est qu’un roman, il a peut-être eu une réelle influence sur Édouard Limonov qui l’aurait lu comme s’il s’agissait d’un véritable manifeste. En cette fin des années 1980, le poète russe publie aussi bien des textes dans L’Humanité (le quotidien du PCF était encore lu) que dans le mensuel d’extrême droite Le Choc du mois ; on le retrouve donc forcément à partir de 1989 dans la seconde période de L’Idiot international, un journal « rouge-brun » (il aurait inventé cette formule)27. Mais actualité internationale oblige, Limonov se trouve attiré vers l’Est, la Russie, mais aussi les Balkans où un engagement physique aux côtés des Serbes provoque, par ricochet, un brusque effondrement de sa cote d’amour parisienne. Thierry Marignac ne le retrouve que quelques années plus tard, à Moscou : le poète est devenu rien de moins que le leader, forcément charismatique, d’une organisation politique, le Parti national-bolchévique (PNB), qui regroupe jusqu’à 20 000 militants à travers la Russie, les natsbols. Cofondé en 1993 par Limonov et le théoricien Alexandre Douguine, le parti précise dans son programme que « l’essence du national bolchevisme, c’est la haine consumante à l’égard du SYSTÈME anti-humain de la trinité libéralisme/démocratie/capitalisme », et que son but global est « la création d’un Empire de Vladivostok à Gibraltar sur la base de la civilisation russe »28… Mais, surtout, la légende veut que, pour une partie rebelle de la jeunesse, le PNB représente un vivifiant pôle contre-culturel, en particulier grâce à son journal, Limonka (La Grenade), et au groupe de punk-rock sibérien Grazhdanskaya Oborona (Défense civile) ou GrOb dont le leader est Egor Letov29.
En France, les années passant, Thierry Marignac réintègre le monde de l’édition, tout d’abord en empruntant la fenêtre de traducteur, de l’anglais et du russe : « Je m’appliquais à apprendre les cultures traduites, à travers et au-delà de la langue elle-même. L’étude des sous-langues que constituaient le nuyorican des gouapes de Times Square, l’argot des taulards de Stratton, celui des camés d’Odessa, ou des prolos de Tcheliabinsk, me plaçait au carrefour d’une masse stupéfiante d’informations. »
À propos du russe, le traducteur Armand Robin écrivait :
« En cette langue je me suis senti délivré, accompagné ; après une longue quête, je rencontrais des mots frais, violents et touchants, frissonnants d’une tendre barbarie encore mal domptée. Presque tout ce que j’avais à dire, d’autres, sur cette terre de victimes bafouées, l’avaient crié avant moi. J’entrai avec fougue dans cette tempête, devins chose de cet ouragan ; de vastes écroulements me précipitèrent. Aujourd’hui encore, au moment de quitter ces poèmes, je reste loin de ma vie, crucifié sur les steppes. »
Désormais mieux placé, il repère la fenêtre entrebâillée du polar et, progressivement, arrive à glisser des titres chez Fleuve noir, Rivages, la Série noire ou Baleine ; il n’aime guère ce monde mais il s’y forge de solides amitiés, y compris « à gauche ». Il publie divers documents dont un essai sur Norman Mailer dans la collection « Les Infréquentables » du Rocher (un an avant le Lovecraft de Houellebecq). Mais, pour nous rapprocher de notre sujet principal, notons qu’au cours de l’hiver 2004-2005, Thierry Marignac effectue un reportage sur la drogue en Ukraine ; il y rencontre les consommateurs, les trafiquants et les membres d’associations de réduction des risques ; un travail dont il tire un livre30 et pour lequel il aime à rappeler qu’il était financé par l’une des fondations de Georges Soros, ce qui fait plus ou moins rire ses interlocuteurs.
FACE B / RUSSIE (années 2020)
« C’est le paradoxe russe, celui qui ne boit pas,
c’est qu’il est malade. Il ne peut pas. »
Bien qu’extrêmement attiré par les bas-fonds de New York, c’est le tropisme russophone de Thierry Marignac qui s’accentue avec le temps ; on le retrouve ainsi dirigeant chez La Manufacture de livres une collection d’ouvrages russes nommée « Zapoï », mot ne connaissant aucune traduction, car trop typique de ce pays, qui désigne un état de profonde ébriété se poursuivant sans discontinuer durant plusieurs jours31.
Retour à la Russie et au politique, donc à Édouard Limonov que l’on retrouve incarcéré, condamné à deux ans de prison ferme en 2001 pour une improbable « tentative de coup d’État » au Kazakhstan. Son PNB qui se focalisait sur la défense des minorités russes ayant été interdit, il fonde en 2010 une nouvelle organisation politique, L’Autre Russie, dont Thierry Marignac évoque l’« anarcho-patriotisme » et qui, l’année suivante, prend une part active aux grandes manifestations anti-Poutine32. Ce nouveau positionnement ainsi que l’ouvrage que lui consacre alors Emmanuel Carrère33 contribuent à ce qu’il soit partiellement réhabilité en France, littérairement parlant34. En 2012, il voit son projet de candidature à l’élection présidentielle russe invalidée par le pouvoir. Toutefois, l’annexion de la Crimée et les combats au Donbass rebattent les cartes du champ politique et entraînent la constitution d’une quasi-Union sacrée ; les natsbols cessent leurs attaques contre le régime et, désormais, Limonov prône une guerre ouverte contre l’Ukraine.
Malade, le vieux poète effectue un dernier passage à Paris, occasion pour lui de participer, enthousiaste, à une manifestation de Gilets jaunes, accompagné d’un Thierry Marignac plus dubitatif. C’était un an avant sa mort. Dans la nécrologie que lui consacre Libération, l’écrivain de SF Sergueï Loukianenko le décrit comme « l’un des derniers écrivains de l’époque soviétique, qui avait connu l’émigration, la lutte contre le pouvoir soviétique, puis le combat politique en Russie. Avec sa mort, c’est l’ère de la littérature soviétique qui se referme définitivement ».
Guerre de l’information
« La guerre moderne se fait à coups de mensonges, de calomnies, de falsifications, d’exagérations, qui font perdre à l’homme le sens de la réalité. »
Simone Weil
C’est en octobre 2024 que l’ami parisien de Limonov débarque en Russie avec son projet d’écriture. Certains lecteurs – mais ceux-là ont-ils résisté jusqu’ici ? – vont s’interroger sur la crédibilité du récit d’un homme aux fréquentations si « nauséabondes »35. Il ne s’agit tout d’abord pas ici de décerner des médailles de vertu, mais disons qu’a priori, on peut au minimum lui faire autant confiance qu’à un polardeux français de tendance « libertaire » faisant le récit de son séjour à Kiev.
Connaître le parcours de l’auteur, savoir d’où il parle, permet de comprendre certains choix, de repérer d’éventuels biais. On l’a vu, Marignac36 trouve généralement les nationalistes sympathiques, mais dit refuser de se situer sur un échiquier politique37, au mieux accepterait-il l’oxymorique syntagme utilisé par Limonov pour le qualifier, anarchiste de droite – ce qui politiquement n’a aucun sens, mais qui, en pratique, désigne un certain type de personnages, le plus souvent de littérateurs. Il est vrai que, pour sa promo (c’est-à-dire pour vendre ses livres), il fait généralement le tour de ce qu’à gauche on nomme la « fachosphère » (et à droite la « réinfosphère »), dans tout ce qu’elle peut receler comme nuances, de quoi le blacklister du côté mainstream, à moins que ce ne soit l’inverse. Un militant de gauche se débarrasserait de la chose en disant « c’est un facho »38…
Ce qui est davantage intéressant, rassurant, c’est l’aspect non militant de son récit, son parcours peu orthodoxe, sa connaissance du terrain (qu’il fréquente depuis vingt-cinq ans) et de la langue ; de plus, il a l’œil et pas mal de talent pour restituer les ambiances et les comportements. Lui dit s’appliquer à décrire ce qu’il pense être la vérité, forcément, ce qu’il voit, tel l’« appareil de transmission » de Kessel ; il avoue même croire à l’existence de l’objectivité (dont l’un des secrets serait de « parler à tout le monde »), nous voulons bien le croire. Encore faut-il, comme l’énonçait Charles Péguy, « voir ce que l’on voit ». On va le constater, les descriptions et le style de Marignac risquent de désappointer les militants de chaque bord et ne peuvent satisfaire pleinement un lectorat nationaliste français très divisé sur la question de la guerre d’Ukraine39. L’auteur, qui a autant d’amis en Russie qu’en Ukraine, refuse de choisir l’un des camps40. Il se déclare d’ailleurs consterné, depuis des années, par l’idéalisation et l’« angélisme politico-sentimental » d’une partie de la droite pour la Russie, attitude qu’il explique avant tout par une profonde ignorance de la réalité du pays. Quant à ceux qui l’imaginent tout simplement en agent russe, il rétorque : « Les Russes ont autre chose à faire que de payer un hurluberlu comme moi. »
Commençons par les aspects les plus critiquables du livre. Vérités alternatives, fausses nouvelles, fake news : l’une des forces de notre époque est bien son inventivité lexicale pour désigner des phénomènes existant depuis des lustres, ici la manipulation de l’information et la propagande de guerre. Marignac et certains de ses interlocuteurs insistent sur cet aspect : selon eux, alors que les Russes useraient principalement d’une propagande triomphaliste à gros sabots, les Ukrainiens mettraient eux l’accent sur la désinformation, soit afin de satisfaire ou d’inquiéter leurs alliés européens, soit pour démoraliser leur adversaire, formés et épaulés en cela par des réseaux de contre-information britanniques et le MI6 (réellement très impliqué dans le conflit). Il est vrai que notre auteur admet une inclinaison certaine pour les conspirations (loin d’être spécifique à la droite) et pour le Britannique John Le Carré, cet auteur de romans d’espionnage qui a « appris à interpréter toute la vie » de la sorte. Mais, contre certains Français n’expliquant l’histoire que par des complots et des révolutions oranges, Marignac a tout de même assez le nez dans la foule pour constater que le soulèvement de Maïdan a été provoqué par un profond mécontentement populaire et de très réels « ferments de révolte » ; son instrumentalisation est autre chose. Pour ce qui est de la guerre, il y voit, « en partie », la poursuite par d’autres manières d’un conflit entre différents oligarques et clans de la pègre ukrainienne et russe, sur fond de racket économique et de trafic de drogue dans un pays souffrant d’une tradition étatique trop récente… encore un peu loin pour nous des rapports de classes et du choc des grands intérêts capitalistes, nationaux et internationaux41.
Dans Vu de Russie, Marignac prend toutefois pour argent comptant un certain nombre d’informations pour le moins douteuses, qualifiées par les médias européens mainstream de fake news, et cite des auteurs francophones, notamment de la « fachosphère », que nous ne considérons vraiment pas comme les plus rigoureux – mais que dire de la plupart des experts de LCI ou de BFM ? Ce sont les références de son monde, chacun a plus ou moins le sien et, fréquemment, s’y enferme en cette bulle de filtrage informationnel que favorisent les algorithmes des réseaux sociaux, limitant l’exposition à des perspectives opposées, d’où le risque d’auto-intoxication. Chacun en est plus ou moins conscient ; du moins Marignac répète-t-il que les considérations militaires ou géopolitiques ne relèvent pas de son domaine.
Nous sommes par exemple navrés par l’entretien qu’il effectue avec l’ancien militaire français Xavier Moreau, qui est sans doute le plus caricatural des youtubeurs pro-russes42 ; la description que fait Marignac de cette rencontre n’est toutefois pas la plus passionnante, ni la plus chaleureuse. On pense alors à ce journaliste russe qui, quelques pages plus loin, se moque des « gags » et « bobards » dont sont capables les pro-Poutine pour expliquer les difficultés de l’armée russe. Chacun à ses points faibles, mais, qu’on se rassure, le périple de l’auteur n’est toutefois pas celui du parcours touristico-politique type du militant d’extrême droite43. Il se rattrape vite, et bien (nous y reviendrons), car Marignac est plus à l’aise, et donc plus appréciable, dans la description de la Russie au ras de la rue et des comptoirs, des personnages cabossés de la vie ou fracassés de la guerre44. Et les quelques allusions à des youtubeurs français sont peu de chose par rapport aux réflexions et anecdotes autrement substantielles récoltées au cours de descentes de bouteilles de vodka avec un romancier, un musicien de rock, des anciens de l’armé, du GRU (les services de renseignement de l’armée russe) ou des correspondants de guerre chevronnés ; point de révélations fracassantes mais le relevé d’une ambiance, des croquis sur le vif.
Et puis, tout comme il est bon – et fort pénible, il est vrai – de parfois jeter un œil au travail des journalistes de France Inter, LCI, CNews, Arte, ou Le Monde, Marignac nous permet de comprendre ce qu’ingurgitent comme infos les citoyens russes en terme d’« informations » ; en fait ce n’est pas compliqué, c’est tout bonnement l’inverse de ce que proclament les médias d’Europe occidentale.
Exemple : s’ils n’évoquent pas l’épisode de Boutcha, les interlocuteurs de Marignac mentionnent à plusieurs reprises les pillages, viols et exactions commis par les forces ukrainiennes dans l’oblast de Koursk45, à propos desquels, paraît-il, « les témoignages de la population locale abondent » et sont attestés par des « vidéos qui paraissent authentiques » et qui circulent sur les réseaux sociaux… exactions auxquelles, sauf erreur, aucun média mainstream français n’a évidemment fait allusion (nous en avions repéré l’évocation sur d’obscurs réseaux sociaux) puisque seuls les soldats russes seraient capables de ce type de comportements, voire, par nature, les Russes. Quid des civils tués par des drones à Belgorod, d’une bibliothèque endommagée (constaté par Marignac), d’une patinoire bondée touchée par un tir à l’approche de Noël (qu’un témoin relate), des bombardements sporadiques ukrainiens contre les villes russophones du Donbass (qui ont cessé depuis que le front s’est éloigné) ou des blogueurs et journalistes victimes d’assassinats ciblés par le SBU, les services de Kiev ? S’il est difficile d’en connaître l’ampleur, il est évident que de tels événements existent.
Des événements qui réellement sont incroyables dans une Union européenne (UE) où l’on considère que les forces ukrainiennes, défendant le camp du Bien et de la Démocratie, ne sauraient s’abaisser à ce genre de pratiques mais, au contraire, se hisseraient plutôt au rang de deuxième armée la plus morale du monde46.
Où est la vérité ? Effet miroir consternant. Deux récits se présentant comme la vérité s’affrontent – il est parfois difficile de déterminer lequel est le plus bête –, relevant d’une opinion forgée collectivement, politiquement ; le principal étant que chaque citoyen y adhère, que chaque population soutienne son régime, afin d’éviter des troubles qui sont toujours préjudiciables (pour les États).
Avoir conscience de ce phénomène (de cette construction sociale) est important pour comprendre ce qui se passe sous nos yeux. Penser détenir la vérité sur tel ou tel événement ne change rien au déroulement de l’histoire. On ne la modifie d’ailleurs plus comme dans 1984, les corrections sont incorporées ouvertement, mais progressivement. En Occident, les plus grosses fake news se dégonflent lentement (charnier de Timișoara, couveuses de Koweït City, fiole d’anthrax de Colin Powell) et, bien des années plus tard, lorsque cela n’a plus d’impact, elles sont même banalement décryptées dans les manuels scolaires afin d’édifier la jeunesse, et les journalistes peuvent dénoncer la naïveté de leurs confrères d’antan, prouver leur supériorité éthique… Nous serions curieux de savoir comment les manuels d’histoire décriront dans un siècle la guerre d’Ukraine ; le pays réellement responsable du sabotage des gazoducs Nord Stream sera peut-être désigné et les lycéens trouveront ça bizarre, mais cela n’aura pour eux qu’un intérêt très secondaire47 pour tenter de leur faire comprendre les enjeux du conflit.
La Russie est un vieux cinéma
« On attendait le lendemain
Chaque jour, on attendait le lendemain
Dans nos yeux une nuit étoilée
Dans nos yeux un paradis perdu
Dans nos yeux une porte fermée »
Kino
Entre chronique et récit de voyage, Vu de Russie nous transporte d’octobre à décembre 2024 de Moscou à Moscou, boucle passant par Saint-Pétersbourg, Kronstadt, Ekaterinbourg et Belgorod. Le livre se compose d’une série de rencontres ; conversations bienséantes ou enflammées dans des bars, des appartements, des rues, avec une grand-mère auteure de contes pour enfants, des écrivains plus ou moins nationalistes, des traducteurs, des reporters de guerre, des documentaristes, d’anciens membres du GRU, de vieux punks, un ancien taulard, une poétesse, un bibliothécaire, un vigile, des musiciens ou bien encore une pédiatre-neurologue. Y est fait un usage abondant de vodka, de cornichons et de saucisse – image d’une serveuse qui arbore « le sourire de la tendresse ironique des femmes, sous cette latitude, pour l’ivrognerie des hommes » – et parfois même de thé. Marignac retranscrit ces échanges, n’hésitant pas à mettre en doute certaines des assertions de ses témoins. Le fil rouge de cette immersion est de comprendre comment ces personnes ont vécu le 24 février 2022, quel regard elles portent sur la guerre, occasion pour décrire cette Russie qu’il n’a pas revue depuis des années : esquisses, relevés d’ambiance, vrais morceaux de vie quotidienne ; des hommes s’affairant à Kronstadt sur des casiers de pêche, la ferveur de la foule dans une église, les cités-dortoirs des banlieues peuplées en majorité d’immigrés d’Asie centrale ou du Caucase, la place de l’islam, une soirée arrosée dans un restaurant ukrainien de Moscou (si si) ou bien encore le dantesque tableau d’un appartement crasseux où réside un aimable vieux punk, coiffeur et cinéphile, ex-boulimique, mais où on a le droit de garder ses chaussures et de fumer alors que, « dans une maison russe, c’est quasi inconcevable ».
Ces personnes ne sont pas rencontrées au hasard des rues mais à partir du réseau de connaissances tissé par Marignac au fil de ses années de traduction, et aussi via son amitié avec un Limonov dont le fantôme hante les pages – certains interlocuteurs sont très friands d’anecdotes sur le Paris d’Édouard et Natalia – ; il est vrai que le poète russe a grandi, est devenu ouvrier d’usine, puis voyou, à Kharkov, la deuxième ville… d’Ukraine. Cette série d’échanges montre l’aspect entremêlé des populations russes et ukrainiennes, les liens familiaux et d’amitiés, les parcours de vie et professionnels par-delà les frontières, l’aspect fratricide de la confrontation, voire celui de guerre civile. Les soldats russes le disent fréquemment : « nous nous battons contre notre miroir ». L’existence d’un seul peuple (ou du moins de « peuples frères ») est un argument mis en avant par la propagande pour justifier l’annexion de certains territoires et de leur population48. La propagande ukrainienne met quant à elle l’accent sur tout ce qui peut différencier les deux populations, les deux cultures, les deux langues, en insistant ou en exagérant si nécessaire (c’est-à-dire souvent) – la création d’une identité nationale impose souvent des efforts et des sacrifices, au grand dam des diverses minorités ethniques du pays (et ici, en l’occurrence, pas seulement des russophones). Pourtant, si dans les bureaux de Kiev on prend des cours particuliers d’ukrainien sur son temps libre – Zelensky y a été contraint –, dans les tranchées de l’Est, c’est généralement de chaque côté que l’on parle russe.
Russie blanche, de l’autre côté de la guerre
« Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière. »
Blaise Cendras
L’autre côté de la guerre, c’est la prospérité et le dynamisme apparents des grandes villes du pays, pas seulement à Moscou ou Saint-Pétersbourg : conflit lointain, embouteillages, innombrables poids-lourds, magasins regorgeant de marchandises, bars, salles de fitness ou de réalité virtuelle, boutiques de vapotage, marques de voitures ou de vêtements occidentaux, films américains dans les cinémas49, passants rivés sur leur smartphone, immigrés d’Asie centrale ubérisés livrant sans relâche des pizzas (mais pas de sushis), etc. Et puis il y a l’île de Kronstadt, emportée par une fièvre de construction et un boom touristique, ou bien encore l’« utopie réalisée du consommateur » enfin localisée, les supermarchés Auchan auxquels les Russes vouent un quasi-culte et où s’entassent des monceaux de produits arrivés du Kazakhstan ou d’on ne sait trop où50. Et Marignac de préciser qu’à Tcheliabinsk, en Sibérie occidentale, il n’a eu aucun mal à cuisiner son fameux ragoût d’agneau à la bière belge.
Quelques mois plus tard, un journaliste du New York Times le confirme : « Pour la majorité des Russes, la vie n’a jamais été aussi belle. À Moscou […] les investissements colossaux réalisés depuis une dizaine d’années ont fait de la capitale l’une des métropoles les plus modernes au monde. […] Selon un sondage du Centre Levada […] 57 % des personnes interrogées se disaient satisfaites de leur vie. C’est le chiffre le plus élevé depuis 1993, date du début de ce genre de sondage51. »
Certes tout le monde se plaint de l’inflation, et dans la Russie périphérique la situation est sans doute moins flamboyante, mais on reconnaît une société de consommation très proche de l’Occident : « Si une certaine pauvreté se fait sentir dans les vêtements et les véhicules, la rudesse et la familiarité avec lesquelles les gens s’interpellent, elles, ne me semblent marquées que d’un degré en dessous des bas-fonds des villes d’Europe. »
Ce que n’a pas pu voir Marignac, c’est l’amélioration du niveau de vie d’une partie de la population russe du fait de la guerre. C’est notamment le cas dans des régions industrielles (défense et construction mécanique) qui connaissaient le déclin depuis la fin de l’URSS, principalement en Russie centrale, autour de la Volga et dans l’Oural ; des zones où régnait un effroyable chômage mais où les infrastructures industrielles n’ont pas été démantelées. Celles pouvant être utiles à l’effort de guerre ont désormais été remises en route, développées, et fonctionnent 24 h/24 ; le plein emploi est revenu et les salaires des ouvriers ont considérablement augmenté. Un renouveau de l’industrie manufacturière qui ne s’explique pas uniquement par un « keynésianisme militaire52 ».
Et puis il y a les salaires et primes pour les hommes se portant volontaires pour le front, des sommes fort attractives, en particulier dans les régions les plus pauvres de Russie. Il faut noter qu’elles s’accompagnent de nombreux avantages pour les familles, comme des places prioritaires en crèche, des prêts immobiliers à taux réduits, des allégements fiscaux ou bien encore un accès prioritaire aux universités (pour les engagés à leur retour ou pour leurs enfants) : des possibilités d’ascension sociale jusqu’alors inimaginables pour ces populations qui, de plus, bénéficient désormais d’une plus grande considération sociale (y compris les minorités ethniques). D’où, dans de petites villes autrefois sinistrées, l’ouverture de salles de sport, ou de nouveaux cafés et restaurants53. Certains évoquent même les prémisses de la naissance d’une nouvelle classe moyenne dans ces régions autrefois en déclin54 ; en tout cas une couche de la population, de prolétaires, voyant leur niveau de vie s’améliorer, ne pouvant que soutenir le régime en place.
Malgré cette impression d’hyper-activité, l’un des interlocuteurs de Marignac fait allusion aux nombreuses faillites de petites entreprises dans le secteur privé, conséquence des sanctions occidentales ; l’auteur évoque quant à lui les mesures gouvernementales visant à simplifier les formalités administratives en cas de dépôt de bilan et, dans la rue, remarque les publicités pour des sociétés spécialisées en gestion de faillite.
Ce qu’il n’a pas pu voir, ce sont les difficultés de l’économie russe, en particulier le ralentissement de la croissance du PIB début 2025, que Moscou est obligé de reconnaître. La croissance du PIB de la Russie est de 3,6 % en 2023, de 4,1 % en 2024 ; ne devrait pas dépasser 2 % en 2025.
Si certains secteurs sont en difficulté (comme l’automobile, où la baisse de la consommation entraîne un passage à la semaine de quatre jours), une large partie de l’économie, en particulier les secteurs « boostés » par la guerre55, produit quasiment à plein régime ; à moins de procéder à des investissements, il est désormais impossible d’accroître sa production et sa productivité (par exemple en développant la robotisation), mais les taux d’intérêt sont beaucoup trop élevés.
Mais le pays doit aussi faire face à un manque de main-d’œuvre, car l’armée a beaucoup recruté avec des primes et des salaires particulièrement attractifs ; de plus, de nombreux jeunes travailleurs qualifiés ont fui à l’étranger. Du fait de la baisse continue du taux de natalité à laquelle la Russie est confrontée depuis des années – malgré les mesures natalistes prises par le gouvernement –, le pays devra dans les prochaines années importer des travailleurs qualifiés alors que, jusqu’à présent, Moscou restreint l’immigration ; l’Asie centrale ne pouvant les fournir, les patrons russes iront probablement se fournir en Chine, au Vietnam ou en Inde56.
Marginalement, les « réfugiés idéologiques » venus d’Europe ou d’Amérique du Nord, dont l’accueil est désormais facilité (depuis août 2024, l’État cherche à attirer, grâce à un programme simplifié d’installation, des professionnels des secteurs de la haute technologie), pourront y contribuer ; notre auteur croise d’ailleurs à deux reprises des entreprises gérées par des expatriés ou des binationaux facilitant l’installation en Russie de Français, preuve qu’il existe un petit marché pour les personnes attirées par les « valeurs traditionnelles » et la qualité de vie mises en avant par le régime.
Russie côté obscur
« Elle est juste en face de toi
Une cuillère à la main
Et la cuillère est en plastique
Que peut-on faire de ça ? »
Taxi Girl
Ces chroniques de guerre ne sont toutefois ni une apologie de la Russie, ni une célébration de son régime, qu’il serait, il est vrai, malaisé de décrire comme un havre démocratique. S’il est délicat de départager, en termes de niveau de violence, CRS et OMON pour la dispersion de manifestants, ou épineux de savoir qui de la Russie ou certains États dits démocratiques censurent le plus efficacement Internet57, c’est sans doute au niveau judiciaire que la différence est la plus flagrante, avec des verdicts et des peines arbitraires spectaculaires qui peuvent être prononcées à la demande, en fonction des besoins.
La répression du mouvement antiguerre a été, en 2022, ferme, rapide et efficace ; les premières manifestations de citoyens ont vite cessé, les militants les plus visibles (opposants politiques, artistes, journalistes) condamnés, des internautes ordinaires ont subi arrestations et condamnations pour de simples commentaires sur les réseaux sociaux (de l’amende à la prison ferme) au titre d’une loi ad hoc interdisant la diffusion de fausses nouvelles ou toute « discréditation » de l’armée. Marignac reconnaît avec un certain euphémisme la situation « parfois délicate » dans laquelle peuvent se retrouver les opposants à la guerre.
La justice doit si nécessaire produire des exemples afin que chacun ait en tête l’épée de Damoclès qui menace ; s’il est difficile d’assurer un réel contrôle sur une population si nombreuse répartie sur un aussi vaste territoire, le risque doit toujours exister. Marignac rapporte un proverbe ouralien selon lequel « la sévérité des lois russes est compensée par leur non-application ».
Le livre confirme des intuitions : les opposants à la guerre sont rares bien qu’ils semblent majoritaires dans les cercles de l’encadrement culturel – on peut le percevoir comme une forme d’occidentalisme moderne –, mais ils doivent publiquement faire profil bas : Marina Ovsiannikova, journaliste qui en 2022 a brandi une pancarte antiguerre en direct à la télévision, a ainsi été condamnée à huit ans et demi de prison58. Les interlocuteurs « dissidents » de Marignac ne se sont toutefois pas cachés pour lui parler, ce qui n’aurait pas été le cas dans certaines dictatures. Le risque n’est pas forcément d’être tué ou incarcéré mais, plus certainement, de subir des répercussions en matière d’emploi ou de carrière. Il serait malvenu pour le pouvoir d’incarcérer des artistes trop populaires, mais assez simple de réduire leur programmation59.
En politique, une certaine notoriété n’est toutefois pas gage de protection, car la répression doit aussi prévenir ou réduire de réels dangers ; elle ne cible donc pas seulement de sympathiques démocrates wokes. Parmi les raisons ayant poussé la classe dirigeante à attaquer l’Ukraine (que nous avons décrites par ailleurs60), il y a bien le risque, en cas d’inaction, d’être renversée par une force d’opposition plus dure, une force qui pourrait traiter Kiev de manière beaucoup plus brutale (c’est possible) : les « turbos-nationalistes » ou « nationalistes Z » les plus excessifs, tolérés au début du conflit, ont depuis été sévèrement recadrés. Thierry Marignac décrit le cas d’Igor Strelkov, vétéran de Bosnie, de Tchétchénie et du Donbass, véritable légende de ces milieux, opposant au régime et rude critique de la gestion de la guerre, qui en 2023 a écrit sur Internet deux articles de trop et s’est trouvé condamné à quatre ans de prison pour « extrémisme ». Rappelons que Poutine peut être perçu en Russie comme un modéré et un centriste de droite ; il ne suffirait évidemment pas de se débarrasser de lui pour mettre fin à la guerre.
La Russie, c’est aussi la propagande de guerre passablement lourdingue à la télévision (davantage que celle que l’on subit en France) : les talk-shows télévisés nationalistes (dont le Soloviev live dans le style Cyril Hanouna qui semble être l’unique source d’information des journalistes français) ; les spots de recrutement de l’armée (que l’on qualifierait ici de masculiniste et à côté desquels les campagnes de l’armée française passeraient pour de fades bluettes) ; le debunkage des fake news occidentales ; la propagation d’autres fake news ; etc.
Les partisans de la guerre que Marignac rencontre insistent sur les carences et défaillances de l’État qu’il s’agirait de corriger, en premier lieu bien sûr la corruption qui gangrène le pays à tous les niveaux et qui fait souvent la une de la presse, comme lors de l’arrestation en avril 2024 de Timour Ivanov, l’adjoint du ministre de la Défense. Un témoin évoque notamment la préjudiciable culture du secret au sein de l’armée et ses erreurs de communication. Certains reporters de guerre promeuvent l’idée que, pour en finir avec l’incurie de la machine bureaucratique, il faut « dire la vérité » et reconnaître les erreurs et les échecs de l’état-major : par exemple le fait qu’en février 2022 les troupes manquent de moyens de transmission et que les officiers n’ont pas imaginé que Kiev puisse détruire ses propres relais et antennes ou couper ses opérateurs téléphoniques (sauf un seul inaccessible aux Russes) ; ou bien encore l’évacuation de la rive gauche du Dniepr à l’automne 2022, réalisée sous la pression de l’armée ukrainienne mais présentée comme une mesure de « raccourcissement du front ». Des discussions autour d’un verre qui reflètent les débats au sein de la classe dirigeante russe.
Et puis il faut signaler l’un des champs d’expertise de notre auteur, la toxicomanie. Dans l’espace slave, « les super-stimulants sont le fléau principal, loin devant les opiacés ». Marignac décrit l’inquiétante croissance de la consommation de drogue, désormais ubérisée : « Tu commandes sur le Dark Web, tu paies avec ton téléphone, un Tadjik vient la livrer en scooter. Exit le romantisme des rues sombres, des mauvaises rencontres, des échoppes à double comptabilité dans les marchés près de la gare » ; il repère les consommateurs dans les rues, les publicités sur les murs pour des cliniques proposant des cures miracles ou les pochoirs indiquant des adresses Telegram où commander de la came. Avec toujours son trip un brin conspi, Marignac s’interroge sur le rôle que pourraient jouer les services américains dans la diffusion croissante de certaines drogues ce qui, a priori, nous semble peu probable, bien que la drogue ait déjà été utilisée comme une arme – il est par contre probable que des fonctionnaires américains n’interviennent pas s’ils repèrent des réseaux ou cargaisons de drogue à destination de pays jugés hostiles. Il note que si les ONG « de type Soros » ont été expulsées du pays car accusées de propagande pro-occidentale, les associations russes de réduction des risques agissent (comme partout dans le monde) avec beaucoup de pragmatisme, c’est-à-dire qu’elles appliquent les principes recommandés par l’ONU sur la question, tout simplement car ce sont les plus efficaces.
Russie patriotique
« Arrache tes propres fils – pantin ! »
Natalia Medvedeva
Évoquant un homme de 45 ans, engagé volontaire, devenu démineur sur le front, Marignac s’interroge : « Pourquoi, avec cinq enfants à charge et au désespoir de sa femme, l’homme mûr prend-t-il encore de tels risques ? Parce que je ne peux pas rester sans rien faire, répond celui-ci. Au fil de mes interviews côté russe, c’est une phrase qui reviendra souvent, notamment avec des types qui ont largement passé l’âge où l’on est apte à combattre. »
Cette série d’entretiens confirme une fois de plus ce que tout le monde est obligé de reconnaître, l’existence d’un véritable soutien populaire à l’opération miliaire en cours, soutien pouvant varier en fonction de l’âge, mais qui reste constant depuis février 2022 malgré la lassitude et l’envie du retour à la paix croissantes que montrent les sondages61. Un soutien envers les populations russophones d’Ukraine, certes, mais avant tout à destination de la Russie, de la patrie. Un soutien qui transcende les opinions concernant Poutine qui, ici, incarne l’ordre et l’État. L’Union sacrée s’impose depuis la droite jusqu’au Parti communiste et les désaccords relatifs à la politique nationale passent au second plan, comme s’ils relevaient de problèmes de famille à mettre de côté en cas de menace extérieure et, aujourd’hui, en l’occurrence, ce qui est ressenti par les Russes comme la menace qui rôde et se rapproche n’est rien de moins que l’OTAN – l’Ukraine est désormais perçue, assez justement, comme un proxy chargé d’abreuver le terrain en chaire humaine.
Beaucoup de Russes se doutent qu’une défaite militaire en Ukraine signifierait une soumission aux États-Unis, comme ce fut le cas durant les « sauvages années 1990 », celles de la présidence Eltsine (1991-1999), donc le retour des oligarques (qui alors méritaient leur étymologie)62, de la corruption (alors incommensurable), du dépeçage de l’économie, des velléités séparatistes, de l’effondrement de l’espérance de vie, etc.
De fait, les plus politisés des interlocuteurs de Marignac, les plus durs, confessent le soulagement et la satisfaction ressentis le 22 février à l’annonce d’une offensive tant attendue. Moscou connaît alors, un peu comme à Kiev, un élan patriotique populaire dont il est difficile de mesurer l’ampleur et le niveau de spontanéité, d’autant qu’il a été encouragé et encadré par l’État63. Des bénévoles se mobilisent auprès d’associations notamment pour venir en aide aux centaines de milliers de réfugiés ukrainiens en provenance des régions conquises par l’armée russe ou, plus tard, aux Russes de l’oblast de Koursk – cela peut sembler paradoxal mais il faut rappeler qu’un à deux millions d’Ukrainiens fuyant les combats ont trouvé refuge en Russie64. Une partie de la société avait réagi ainsi en 2014-2015 afin de soutenir les séparatistes et les réfugiés de Donetsk et Lougansk ; on retrouvait là encore ces gestes de solidarité de chaque côté, quasiment le « même phénomène populaire d’assistance matérielle aux combattants, en dehors du pouvoir […]. Les deux faces du miroir fratricide… ».
On croise ainsi, à plusieurs reprises dans le livre, les membres d’une association d’écrivains qui mène ce type d’actions à destination du Donbass, livrant parfois un chargement d’instruments pour des écoles de musique de la région, ou bien un lot de gilets pare-balles pour les combattants locaux.
Le patriotisme a toutefois des limites, puisque Marignac rapporte que les prix de l’immobilier grimpent en flèche dans les régions d’accueil de réfugiés. Et puis il y a tout de même ceux qui sont opposés à l’Opération spéciale, minoritaires dans le livre – l’auteur le reconnaît – et sans doute dans la société, sauf peut-être dans les classes moyennes et supérieures, notamment chez les intellectuels ou artistes rencontrés, les « voix dissidentes » de l’ouvrage. Il est à noter que, dans le livre, la plupart d’entre eux semblent en complet décalage avec les nationalistes, étant par exemple particulièrement surpris par l’offensive du 24 février et ayant vécu ces premières journées dans un profond effarement, une totale incompréhension, suivis d’un sentiment de peur et d’abattement, allant parfois jusqu’à des velléités de fuir à l’étranger.
La Russie au combat
« La tension de la guerre est une défonce
en soi largement suffisante. »
Sentiment d’une guerre lointaine, sentiment que le pouvoir fait tout pour entretenir afin de préserver la paix sociale… Une guerre qui pourtant peut tomber quelquefois du ciel, sous la forme d’un drone ukrainien visant une installation militaire ou bien une usine, mais qui « tape » à côté ; chose de plus en plus fréquente en 2025. Marignac remarque d’ailleurs qu’un « tranchant invisible de paranoïa aiguillonne tout le monde », phénomène dont il est difficile de connaître l’ampleur ; il l’illustre par le cas d’une amie moscovite : la porte de son appartement menant au palier n’est jamais verrouillée afin de faciliter l’évacuation en cas d’incendie provoqué par un drone.
Il est une autre crainte, spécifique aux hommes. À partir de février 2022, mais surtout de septembre 2022 avec l’annonce de la mobilisation de plusieurs centaines de milliers de réservistes, beaucoup de jeunes gens se réfugient en Géorgie, en Arménie ou en Turquie. Marignac croise lors de son séjour automnal, fin 2024, un étudiant qui prolonge son cursus pour échapper au service militaire car il ne souhaite pas se « faire trouer la peau pour des gens qui, eux, n’iront jamais sur le front ». Pourtant, si lors de l’attaque initiale de février 2022, ou lors de l’offensive ukrainienne dans l’oblast de Koursk, des appelés ont participé aux combats (avec peu d’efficacité), on sait que désormais opère sur le front une armée de volontaires, les krontratnik – une grande nouveauté pour l’armée russe. On sait que des spots publicitaires et des campagnes d’affichage proposent des salaires extrêmement attractifs pour ceux qui s’engagent et des primes considérables aux familles en cas de décès ; mais Marignac les décrit dans les rues des grandes villes de l’Ouest de la Russie (alors qu’en France, beaucoup imaginent le recrutement réservé aux populations des régions reculées et aux minorités ethniques) ; d’ailleurs, son ami correspondant de guerre (loin d’être un dissident) évoque les cimetières des environs de Moscou « pleins à craquer ».
La Russie doit faire face à un nombre important de réfractaires et d’insoumis, mais n’est pas confrontée à l’ingérable problème de déserteurs que connaît l’Ukraine65 ; l’accroissement de la conscription et son utilisation à l’arrière ont libéré de la main-d’œuvre pour le front ; n’engageant pas l’entièreté de son armée, elle peut se permettre une rotation régulière de ses unités qui, de plus, sont dans une dynamique offensive positive (donc bonne pour le moral), et disposent pour l’instant de conditions de travail supérieures à celles des Ukrainiens (bien que nous les jugerions totalement insupportables). De plus, on l’aura compris, les soldats russes sont efficaces et motivés, coûteux (même en cas de décès), donc précieux ; c’est pour cela que, contrairement à ce que proclament les médias français, ils ne sont pas gaspillés sur le terrain66.
Invité par un ami, Marignac fait un court séjour à Belgorod, ville régulièrement sous le feu de l’armée ukrainienne à 40 km de la frontière, et y découvre des abris à chaque coin de rue et des alertes quotidiennes, mais des habitants a priori indifférents. Une Russe ayant vécu au Liban dans les années 1970-1980 lui rappelle une banalité, que « les gens s’habituent à la guerre ». Son hôte, en connaisseur, admet que les Ukrainiens visent avant tout des objectifs militaires ou assimilés, ce qui, vu la difficulté du conflit, est le plus rationnel pour les deux armées.
Marignac, qui ne fait à ce moment-là qu’une brève escapade en 4×4 vers la frontière, écourtée du fait de la présence d’un drone ukrainien, explique qu’il ne ressent pas exactement de peur, mais plutôt « un état d’alerte qui se glisse sous la peau ». Les hommes qu’il côtoie, anciens militaires ou journalistes de guerre, ont quant à eux l’expérience du combat ; d’où un récit truffé d’anecdotes sur le quotidien du champ de bataille qui renvoient fréquemment la rusticité de l’armée russe et la « légendaire débrouillardise des Slaves, habitués à survivre dans des conditions précaires grâce au système D ». Ce journaliste de WarGonzo évoque par exemple la question (classique) de la peur : « Personne, avant d’en avoir fait l’expérience, ne peut savoir quelle sera sa réaction en situation de guerre ; la panique totale est possible. Dimitri parle de soldats paralysés par la peur. […] Dimitri me parle d’une sensation que je connais, quoique dans des circonstances bien moins extrêmes. Le ralentissement du temps, un grand calme, en apparence tout au moins, une attention totale à l’extérieur. Tu n’as pas le temps d’avoir peur… » L’ancien chauffeur de Limonov évoque quant à lui ces hommes des troupes d’assaut qui ont statistiquement peu de chance de survivre à plus de cinq attaques mais qui s’y préparent, puis foncent en « un mélange d’entêtement, de défi, de discipline et de résignation ». Des témoignages de guerre parfois hallucinants, comme lorsqu’il est question d’une unité de forces spéciales cosaques chargée de repérer puis de remorquer les véhicules blindés susceptibles d’être réparés… à proximité de combats en cours ! Au fil de la vodka émergent des informations moins anodines, comme le fait que, désormais, les « mercenaires étrangers » (c’est-à-dire les anciens militaires occidentaux volontaires / détachés dans l’armée ukrainienne) sont systématiquement exécutés en cas de capture67.
À noter l’évocation assez inhabituelle du Donbass (et dans une moindre mesure de la Crimée) comme « territoire libre ». Ces zones à l’autorité et à l’identité administrative ambiguës sont devenues depuis 2014 une véritable « porte de sortie de l’espace confiné de Russie », refuge de nombreux marginaux, « de tas de punks et de hippies » dans leur version russe (c’est-à-dire assez rugueuse), de criminels et délinquants en fuite, jusqu’à l’installation d’une secte d’hérétiques orthodoxes en Crimée. La proximité du danger permet de ressentir la vie plus intensément, en une « fraternité immédiate » et « la guerre permet d’y vivre en dehors des normes ». Un espace de liberté, mais à condition que l’on s’y tienne « à carreau et qu’on participe à l’effort de guerre ».
De nombreux militants d’extrême droite réprimés en Russie y trouvent ainsi refuge – alors que l’idéologie officielle des entités séparatistes s’inspire de « l’antifascisme » et de « l’internationalisme » soviétiques – ; à tel point que certains nationalistes en viennent à critiquer Moscou pour avoir transformé la région en un « dépotoir du monde russe »68. La situation s’est semble-t-il normalisée avec le rattachement des oblasts à la Fédération de Russie et l’intégration progressive des forces locales à l’armée russe. On était bien loin de l’expérience de Fiume.
Un monde de brutes… et de poètes
« Je lis mes vers à des prostitués,
Avec des bandits me gorge d’alcool. »
Sergueï Essénine
La confrontation entre la Russie et l’Occident peut se nicher dans des domaines inattendus. Certains interlocuteurs de Marignac mentionnent ainsi la guerre culturelle menée sur leur propre sol à coups de soft power et de blockbusters dont ils repèrent des échos jusque dans la littérature du pays. D’après l’ancien secrétaire de Limonov, « les auteurs post-modernes de l’Oural ou de Saint-Pétersbourg viennent d’une génération de privilégiés qui ont grandi subventionnés par l’argent de l’Ouest. Ce qui a suscité la réaction inverse, une littérature populiste-réaliste […], regroupée parfois autour de manifestes éphémères. Il est tentant d’y voir une réminiscence au XXIe siècle, une résurgence de la vieille opposition “occidentalistes-slavophiles” du XIXe ».
Nous permettre une plongée initiatrice dans les eaux de la littérature et la poésie russes contemporaines est sans doute l’aspect le plus agréable et stimulant de Vu de Russie. Le plus inattendu aussi, la guerre et la poésie n’étant généralement pas perçues comme des domaines très compatibles. Rimbaud ne s’est-il engagé dans l’armée coloniale néerlandaise après avoir interrompu ses prouesses littéraires ? A contrario, l’immense Khlebnikov n’a-t-il pas forgé le terme poietz en mêlant les mots russes de « poésie » et de « combattant » en une sorte de « combaète »69 ? Les poèmes de guerre existent pourtant, donc les poètes de guerre, ou du moins des poètes pris dans la guerre… Question de point de vue et, ici, l’auteur Marignac est exempt d’objectivité.
Premier biais, il est l’ami parisien d’un Limonov « guerrier » ayant publié plusieurs recueils de poèmes en Russie et se félicitant d’avoir conscience « qu’écrire des vers est une activité quasi moyenâgeuse, une telle excentricité au XXIe siècle, c’est se complaire dans un vice ».
Deuxième biais, il considère que « tous les Russes sont poètes, et [que] l’écrasante majorité des poètes est constituée de casse-burnes à expédier au goulag régime sévère pour les empêcher d’écrire, toutes nationalités confondues ». La Russie cultive, il est vrai, un rapport privilégié à la poésie, peut-être parce que cette forme a longtemps été un moyen (pas toujours sans risque) de contourner la censure ou de s’évader ; toujours est-il que c’est une contrée où les bons poètes peuvent bénéficier « d’un statut de rock star ». Dans un pays comme la France, où il n’y a plus guère de guerriers ou de poètes, et où, d’ailleurs, on n’apprécie ni les uns ni les autres, le phénomène paraît pour le moins énigmatique.
Troisième biais, il a depuis longtemps succombé au « vertige » de la poésie russe, et s’est essayé à en traduire. En 2012, il a publié en collaboration avec Kira Sapguir Des chansons pour les sirènes, un recueil de textes de trois auteurs qu’il affectionne particulièrement70 ; le premier est très connu, les deux autres beaucoup moins :
Tout d’abord Sergueï Essénine (1895-1925) / Un poète avant-gardiste, symboliste puis imaginiste, membre de ce groupe de « poètes de l’esprit » qui sympathisent avec les socialistes-révolutionnaires de gauche et qui, autour d’Andréï Biély et d’Alexandre Blok, publient la revue Les Scythes. Il meurt très probablement suicidé par les bolcheviques. Paradoxalement, il devient durant la période post-soviétique « l’animal blond des ultranationalistes » (Kira Sapguir). >>
« Je sais que dans cette vie, il n’est de joie concrète
Qu’errance et rêverie d’une âme maladive,
Je sais l’ennui pour tous de mes rengaines dépressives,
Mais je ne suis pas coupable – puisque je suis poète. »
Ensuite Natalia Medvedeva (1958-2003) / L’ex-épouse de Limonov, à « la beauté et l’énergie brute d’une fille délurée de la Sainte Russie », est tour à tour ou simultanément mannequin (notamment pour les pochettes de disques de The Cars), poétesse, écrivaine, musicienne et fondatrice du groupe de rock Tribunal. >>
« Se cacher et simuler
Et attendre la minute inédite
Lorsque prunelles vers les orbites
Se révulsent sous les siècles émeutiers »
Enfin Sergueï Tchoudakov (1935-1997) / Pas mal voleur, un peu mac, dealer, pique-assiette, interné psy, etc. Les personnes qui ont connu « le Lautréamont moscovite » semblent d’accord pour dire que c’est un sale type… >>
« Je suis authentique, je suis régulier,
Ultralumpenprolétaire
À part les chocottes et la trique
Je n’ai aucun sentiment civique. »
Notre plus grande découverte, la plus frappante, aura toutefois été, via les tribulations russes de Marignac, celle d’un quatrième larron, Boris Ryji (1974-2001) : géologue balafré, boxeur amateur, Ouralien suicidé, le « poète voyou » est amoureux « du romantisme hooligan des bas-fonds où il [a] grandi, dans les secteurs délinquants en lisière d’Ekaterinbourg ». Désespoir et délinquance s’entrechoquent dans les textes de ce symbole de la littéraire post-soviétique qui fait l’objet depuis sa mort d’un véritable culte à travers le pays. Un seul de ses recueils a pour l’instant été traduit en français71 ; cela vaut davantage que le détour. Finissons donc cette partie par ces quelques vers :
« Je crois que l’éternel retour nous est échu
et que nous ne mourrons jamais.
Il ne me reste qu’à attendre, attendre en retenant
mon souffle : il finira sa bière, il sourira.
Et ma vie se répétera. »
La neige couvrira tout…
« Le déclin de l’Occident est l’un des thèmes les plus saillants de l’eschatologie russe. Et, de nouveau, la France en est le protagoniste. Ce que Nikolaï Danilevski formule ainsi : la Russie est la tête d’un monde en gestation, la France représente un monde qui disparaît. Cette thèse apparaît souvent dans la pensée sociale russe, et peu importe qu’il s’agisse d’un courant de droite ou de gauche. »
Roman Jakobson
« Moi, je suis absolument convaincu que la mort n’existera plus. On ressuscitera les morts. »
Vladimir Maïakovski
On l’aura compris, la lecture de Vu de Russie nous a paru fort profitable, notamment du fait du large pas de côté que l’ouvrage permet d’effectuer par rapport à nos lectures habituelles, mouvement qui est toujours précieux pour aiguiser son point de vue sur un sujet, ici pour cerner le rapport des Russes à la guerre d’Ukraine et réfléchir à ce que pourrait être l’après-guerre. Et si, de plus, la chose est bien écrite et se lit comme un revigorant récit de voyage, autant en profiter.
À première vue, on pourrait croire que, restée physiquement loin de la guerre, la société russe n’en a été que peu impactée ; on sait que ce n’est pas le cas.
Tout d’abord, d’un point de vue humain, nous avons affaire à une catastrophe. Plusieurs millions d’hommes ont participé aux combats au sein de l’armée russe, des centaines de milliers ont été tués ou blessés ; personne n’en est sorti indemne. Dans son journal intime, Alexandre Blok notait en l’année 1915 avoir « cru en la gloire, en l’honneur des combats, mais la guerre n’a apporté que du sang et des cendres, et nos rêves se sont éteints dans la boue des tranchées ». Quelle société, quel futur pour les anciens combattants, les gueules cassées, les enragés, les têtes brûlées, les agités ? Une fraction de la population qui a connu le feu et qui aspire à la reconnaissance va, d’une manière ou d’une autre, jouer un rôle politique dans le futur. D’ores et déjà, les vétérans sont présentés comme des modèles pour la jeunesse, et le parti Russie unie (celui du président) offre des postes politiques à certains d’entre-eux, ce qui ne satisfait guère ceux dont ils prennent la place. La réintégration des anciens combattants dans un corps social bouleversé est un challenge pour les États impliqués dans un conflit d’une telle ampleur ; on pense évidemment aux pays d’Europe au sortir du premier conflit mondial : désillusions, rancunes, dérives délinquantes ou politiques, voire périples rocambolesques, aventures guerrières ou tentatives révolutionnaires, les possibilités foisonnent. D’un point de vue politique et social, la situation de l’Ukraine, des plus périlleuses, pourrait à court terme se rapprocher de celle de l’Allemagne de 1918, mais sans doute avec davantage de corps francs et moins de conseils ouvriers. En ce qui concerne la Russie, tout va dépendre du règlement politique du conflit ; pourra-t-elle se proclamer victorieuse et, si oui, la population pourra-t-elle le croire ? Difficile de savoir si, toujours comparé à 1918, le sort du pays ressemblera à celui de la France, de la Russie ou de l’Italie (pour la « victoire mutilée »). L’adaptation de Moscou à la paix sera en tout cas très délicate.
Il en sera de même pour son économie, en partie « boostée » par la guerre d’Ukraine et structurellement transformée du fait des sanctions occidentales ; désormais coupé de l’UE, le pays a été jeté dans les bras de la Chine, sans doute définitivement – la coupure est même culturelle et les Russes se perçoivent de moins en moins comme des Européens.
L’idée de l’administration Biden de saigner économiquement et militairement le principal allié de la Chine, pour un coût modeste, s’est avéré un échec ; elle n’est désormais poursuivie que par quelques pays européens alors que, paradoxalement, leur déclin économique s’en trouve amplifié – une défaite de Kiev pourrait en effet les fragiliser et mettre en péril leur projet de construction d’une UE fédérale et autoritaire. Pousser/aider l’Ukraine à combattre un, deux ou pourquoi pas quatre ans de plus, en attendant l’écroulement économique de la Russie et la montée en puissance militaire de l’UE, tel semble être le plan de Bruxelles ; un certain nombre d’études démontreraient d’ailleurs que Moscou – qui ne peut s’arrêter avant d’avoir conquis l’entièreté du Donbass – ne pourrait pas tenir à ce rythme plus d’un an et demi72.
Dans ce contexte, malgré des mois de négociations et de pressions, l’administration Trump n’a pu mettre un terme à la guerre. À l’heure où nous écrivons ces lignes [septembre 2025], l’incertitude domine, rendant tout pronostic impensable ; les tensions s’accroissent toutefois dangereusement. Désormais, les États-Unis accentuent leurs menaces, facilitant par exemple des bombardements ukrainiens en profondeur, notamment contre des raffineries – afin de faire très concrètement connaître aux citoyens russes le goût et le coût de la guerre –, ou en annonçant de nouvelles livraisons de matériel militaire.
On se dirige soit vers un effondrement (progressif ou brutal) de l’armée ukrainienne, soit vers une escalade militaire du fait d’une implication croissante ou directe (volontaire ou pas) de pays occidentaux, soit les deux ; bref, une poursuite de cette boucherie. Un accord de cessation des combats, sinon de paix, aurait au moins le mérite d’y mettre un terme, même s’il est probable (vu les logiques qui sont à l’œuvre) que cela ne soit qu’une pause permettant à chacun de se préparer à une suite d’une tout autre ampleur… Nous y reviendrons forcément.
Peut-être aurait-il été plus pertinent de placer la citation de Maïakovski ici, en conclusion, plutôt qu’en exergue de cette partie, ou plus opportun de finir par quelques vers d’un poète russe pas trop désespéré. Oui, sans doute.
Tristan Leoni, septembre 2025.
1Thierry Marignac, Vu de Russie. Chroniques de guerre dans le camp ennemi, Paris, La Manufacture de livres, 2025, 256 p.
Une fois n’est pas coutume, je vais tenter de ne pas (trop) multiplier les notes de bas de page. Les citations sans référence sont tirées des ouvrages de Thierry Marignac – les plus biographiques proviennent de Photos passées (La Manufacture de livres, 2023) – ou des nombreuses interviews données par l’auteur dans la presse papier, sur les chaînes Youtube et autres radios.
2Évidemment, si un lecteur peut me conseiller un livre du même acabit écrit par un anarchiste ou un marxiste hétérodoxes, je prendrais l’information avec réellement beaucoup d’intérêt.
3Synonyme quelque peu raffiné pour « fachos ».
4L’interview paraît dans Actuel mais je ne l’ai pas retrouvée, ni même réussi à identifier le numéro dans lequel elle a été publiée. Si vous avez l’information ou le texte, je suis preneur !
5« La langue de Limonov est violente, dérivée des jargons de la banlieue de Kharkov, dont il a décrit les loubards dans son Autoportrait d’un bandit dans son adolescence. La fraternité avec les terroristes, les paumés, les violents des bas-fonds de la planète actuelle est une fraternité d’exilé. Limonov en arrive finalement à mettre un signe d’égalité entre tous les systèmes et toutes les “oppressions”, rejoignant ainsi la grande famille des révoltés à la Genet ou la Charles Bukowski. La langue de Limonov est son principal instrument de révolte : c’est en avilissant, en humiliant, en précipitant dans les jargons de loubards et les graffiti de latrines la langue russe malade de son puritanisme, que Limonov hausse sa révolte à une intensité, une dureté, un défi que les traductions ne peuvent qu’aplatir. L’exil ici a principalement levé les tabous stylistiques… », Georges Nivat, « Exil russe dans la nuit européenne », Versants. Revue suisse des littératures romanes, no 10, 1986, p. 99-100.
6J’ai demandé à une IA de vérifier cette information mais elle en a été complètement incapable. Tout n’est pas perdu.
7François Mitterrand (1916-1996) est un homme politique français du XXe siècle. Militant tout d’abord à l’extrême droite, il évoluera avec le temps vers le centre gauche. Ministre de la Justice durant la guerre d’Algérie, il est le candidat de l’union de la gauche à partir de 1965, jusqu’à sa victoire en 1981.
8Sur cette question, voir Tristan Leoni, « Racisme en Provence », DDT21, 2017.
9Le plan de rigueur vise en particulier à réduire le déficit budgétaire. Il se traduira par une augmentation des prélèvements obligatoires (augmentation des tarifs publics, de diverses taxes, de l’impôt sur le revenu et de la TVA, création du forfait hospitalier, etc.) et une réduction des dépenses publiques (sécurité sociale, allocations chômage, certaines retraites, etc.), et s’accompagnera de la destruction de certains secteurs industriels récemment nationalisés (charbon, acier) et de dizaines de milliers de licenciements.
10L’Europe étant une priorité, il ne s’agit donc pas tant d’un tournant que d’une confirmation. Un des acteurs de cette période préfère d’ailleurs l’image du carrefour où « on s’arrête au stop, on regarde à droite, à gauche et puis on continue tout droit ». Georges Saunier, « La politique économique de la gauche et le tournant de 1983 », Fondation Jean Jaurès, 2016.
11Il y a en France, en 1983, 1,2 million d’étudiants, contre près de 3 millions de nos jours.
12« Mai 1983 : bataille d’arrière-garde des classes moyennes », Échanges, n° 35-36, avril-juillet 1983, p. 6.
13Le Parti des forces nouvelles (PFN), fondé en novembre 1974, est issu d’une scission de militants du FN essentiellement issus du mouvement Ordre nouveau. En concurrence avec le parti de Jean-Marie Le Pen pour le leadership à l’extrême droite, il est à cette époque très lié au Groupe union défense (GUD).
14Il faut lire la description que fait de lui (ainsi que de l’art fonctionnaire et des artistes ralliés à son ministère) Guy Hocquenghem dans sa Lettre ouverte à ceux qui sont passés du col Mao au Rotary (Albin Michel, 1986).
15« Mai 1983 : bataille d’arrière-garde des classes moyennes », op. cit., p. 8.
16Jeter un œil aux vidéos disponibles sur Internet dans lesquelles il est interviewé vaut le détour pour comprendre cette époque.
17Témoignage de « Bruno » dans l’une des trois brochures sur l’histoire du mouvement autonome en France disponibles sur Infokiosques.net. Elles sont tirées du mémoire de maîtrise de Sébastien Schifres, Le mouvement autonome en Italie et en France – 1973/1984, mémoire de Master 2 de sociologie politique, Paris VIII, octobre 2008, sous la direction de Daniel Lindenberg.
18Danielle Tartakowsky y consacre toutefois une page dans son ouvrage Les droites et la rue. Histoire d’une ambivalence, de 1880 à nos jours (La Découverte, 2014). Plus récemment, on observe encore ce genre de comportement avec, par exemple, deux des plus puissants « mouvements sociaux » ayant eu lieu en France ces dix dernières années, la Guyane en 2017 et Mayotte en 2018 (une grève générale, excusez du peu), desquels les journalistes-militants de gauche ont pudiquement détourné le regard.
19Brice Couturier, Une scène-jeunesse, Paris, Autrement, 1983, p. 193.
20Cette stratégie n’est dévoilée au grand public qu’en 1994 avec la publication au Seuil du livre d’Emmanuel Faux, Thomas Legrand et Gilles Perez, La main droite de Dieu. Enquête sur François Mitterrand et l’extrême droite.
21Sur cette question, on lira avec intérêt le communiqué d’autodissolution du SCALP-Reflex daté du 12 janvier 2013.
22Christian Fermanville, « La passion politique pour dernier espoir » (entretien avec Thierry Marignac), Le Choc du mois, n° 12, novembre 1988, p. 67-68.
23L’ouvrage est réédité en 2015 par ActuSF dans la collection « Hélios noir ».
24Christian Fermanville, op. cit.
25« Thierry Marignac : l’interview en roue libre », Le blog du polar de Velda, juin 2015.
26« Interview de Thierry Marignac », in Thierry Marignac, Fasciste, Paris, ActuSF, p. 193.
27Guy Debord aurait défini L’Idiot international comme « une tribune où vont s’acoquiner notoirement les suspects des plus diverses origines ». Cf. L’Idiot international, une anthologie, Paris, Albin Michel, 2005, p. 208.
28Sur le PNB, on peut lire Véra Nikolski, « Le Parti national bolchevique russe : une entreprise politique hétérodoxe », Critique internationale, no 55, 2012, p. 93-115.
29Sur le punk sibérien des années 1980, on peut regarder le documentaire de Vladimir Kozlov, Traces in the snow (2014, 63 min), ou lire : Vladimir Kozlov et Alina Simone, « Punk et rébellion dans la Sibérie des années 1980 », Vice, avril 2015. Plus spécifiquement sur le parcours de Egor Letov : Marc Bennetts, « Raging in the cold: the Siberian punk who changed the face of Russian music », New East Digital Archive, 2014.
30Thierry Marignac, Vint. Le roman noir des drogues en Ukraine, Paris, Payot, 2006, 208 p. « Vint » est le surnom d’une méthamphétamine fabriquée localement dans des laboratoires clandestins, très courante en Ukraine, Russie et Biélorussie.
31Dans cette collection, j’avais lu Guerre de Vladimir Kozlov (auteur que l’on croise dans Vu de Russie), l’histoire (vraie) de quelques jeunes de la Russie périphérique qui, au début des années 2000, décident de passer à la lutte armée contre la police (La Manufacture de livres, 2016). Il est aussi l’auteur de documents sur le punk sibérien, voir note 29.
32Véra Nikolski note qu’à partir de 2000 Limonov « troque progressivement une idéologie nationaliste contre des thèses plus anarchistes et libertaires, et s’allie avec les libéraux ». Véra Nikolski, op. cit., p. 105.
33Ceux qui ont connu le poète semblent détester ce livre, et Limonov lui-même a toujours refusé de dire ce qu’il en pensait. Pour une introduction à Limonov, on peut essayer de trouver d’occasion Limonov par Edouard Limonov, une série d’entretiens (assez drôle) réalisée par Axel Gyldén, (Express Roularta, 2012).
34La capacité occidentale de passer l’éponge sur un curriculum vitæ quelque peu « radical » relève toutefois, lorsque c’est utile, de prodiges acrobatiques. On a pu y assister avec l’opposant Alexeï Navalny (1976-2024) passé, après une formation accélérée, de militant d’extrême droite raciste à sympathique chantre de la démocratie libérale. À l’heure où nous écrivons ces lignes, on peut se demander si l’on n’assiste pas à un tel processus en Ukraine avec le général de brigade Andriy Biletsky, leader néonazi du mouvement Azov.
35Certains pensent qu’il ne faut pas lire de livres « de fachos », ni même en parler, que c’est plus prudent. Il y a certes une injonction morale, presque religieuse, qui prescrit de s’éloigner du Mal, ne serait-ce que littérairement ; voire une injonction prophylactique puisqu’il semble désormais courant de percevoir le Mal / fascisme comme une maladie dont il suffirait de se prémunir pour rester sain / supérieur. On peut aussi y voir, au fond, une croyance sympathique en la puissance de l’écrit, objet magique dont la lecture est susceptible d’entraîner de brutaux revirements d’opinion. Pourtant, si un tel bouleversement se produit parfois, c’est bien que des conditions diverses y ont intellectuellement et psychologiquement préparé le lecteur ; ne manque qu’une étincelle, ici un livre, là une rencontre ou un événement. Craindre de lire tel ouvrage ou tel auteur, choisir de ne lire que ce qui, a priori, nous conforte dans nos positions c’est, outre la preuve d’un triste manque de curiosité, un signe de la fragilité de ses positions, certainement pas un moyen de les consolider.
36Ceux qui ont lu Photos passées comprendront que je me sois jusqu’alors abstenu d’éluder son prénom.
37Le fait, pour un auteur catalogué à l’extrême gauche, et vivant de sa plume, de donner des interviews à CQFD, Silence, Le Monde libertaire, La Décroissance, L’Anticapitaliste et Courant Alternatif, n’indique que très vaguement son positionnement politique.
38Signalons que Thierry Marignac n’apparaît pas dans le livre de Nicolas Lebourg et Olivier Schmitt, Paris Moscou. Un siècle d’extrême droite (Seuil, 2024), ouvrage qui, pourtant, relève d’un name dropping carabiné.
Le terme « fasciste » s’est particulièrement démonétisé ces dernières années du fait de son utilisation « à gauche » comme synonyme de « personne avec laquelle on n’est pas d’accord ». On notera qu’en URSS, dans l’argot des tchékistes et des truands, « fasciste » désignait un individu arrêté en vertu d’un article politique. Cf. Jacques Rossi, Le manuel du Goulag, Paris, Le Cherche Midi, 1997.
39Seule une poignée de radicaux assument ouvertement un positionnement pro-Poutine. La plupart, et notamment les plus pragmatiques, tel le RN en quête de respectabilité – mais peut-on encore le catégoriser comme d’extrême droite ? –, ont adopté la vision européo-atlantiste dominante. Au vu de ces capacités de revirement, on comprend que si ingérence russe il devait y avoir, elle ne favoriserait pas tant l’instauration en France d’un régime nationaliste, fort et souverain, que l’accroissement d’un chaos rampant afin d’affaiblir l’UE dans son ensemble.
40Pour Anne Nivat, auteure de La Haine et le déni (Flammarion, 2024), cette absence de prise de parti (cette volonté de documenter), qui autrefois était un atout et une obligation pour le métier de journaliste, serait presque devenue un handicap avec la guerre d’Ukraine. La publication de ce livre nous avait échappée, nous espérons pouvoir le lire prochainement.
41La présentation de son précédent livre sur les affrontements entre gangs (ceux de l’Est soutenus par la Russie contre ceux de l’Ouest et du Centre soutenus par les États-Unis) ne nous avait pas convaincu. Thierry Marignac, La guerre avant la guerre : chronique ukrainienne, Paris, Konfident, 2023, 180 p.
42Il faut avouer qu’il peut parfois être utile de l’écouter afin de connaître la version officielle du Kremlin sur tel ou tel événement de la guerre d’Ukraine.
43Il ne rencontre par exemple pas certaines figures qui, pour certains pans de l’extrême droite française, sont des références, tel le théoricien Alexandre Douguine (présenté à tort en France comme l’âme damnée de Poutine), ni l’écrivain (publié chez Actes Sud) et activiste (ancien dirigeant du PNB) Zakhar Prilepine, individu que Marignac ne semble guère apprécier et auquel il règle son compte en quelques lignes ; deux personnages qui ont fait l’objet de tentatives d’assassinat, a priori de la part des services ukrainiens.
44Toutes proportions gardées, Thierry Marignac nous fait penser à un auteur qu’il n’apprécie guère, Michel Houellebecq qui, au travers de ses livres, se révèle bien meilleur sociologue de la France contemporaine que certaines cohortes stipendiées par le CNRS, mais qui, lorsqu’il aborde la politique, dit vraiment n’importe quoi. C’est bien pour cette raison (la première) que nous lui avons consacré un article en 2015 sur le site DDT21, « Du spirituel dans l’homme et dans le prolétaire en particulier. Autour de Houellebecq et de “Soumission” ».
45Suite à une offensive surprise dans un secteur mal protégé, les forces ukrainiennes pénètrent dans l’oblast de Koursk, en territoire russe, et occupent plusieurs centaines de km2 de territoire autour de la ville de Suja d’août 2024 à mars 2025.
46Le second degré fonctionne assez mal à l’écrit, surtout au début du XXIe siècle.
47Le sabotage des gazoducs Nord Stream survenu en septembre 2022, authentique acte de guerre touchant les intérêts vitaux d’un pays membre de l’OTAN, l’Allemagne, fut de manière totalement contre-intuitive attribué à la Russie, et ce à la quasi-unanimité des politiques, analystes et journalistes européens. En 2025, la presse occidentale révèle progressivement, et de manière feutrée, que cette attaque est l’œuvre de membres des services ukrainiens – qui, on le dit moins, ne pouvaient agir sans l’aval et le soutien de leurs homologues anglo-saxons, encore moins dans l’une des mers les plus surveillées du monde, un quasi-lac de l’OTAN. Cela n’entraîne aucune conséquence politique.
48Les journalistes français répètent que Poutine aurait déclaré vouloir « détruire l’Ukraine » et donc, selon eux, ses villes et sa population, des mots qu’il n’a évidemment jamais prononcés. Le récit officiel russe, s’il dénonce l’Ukraine en tant qu’entité administrative artificielle, explique que l’intervention de février 2022 visait à libérer la population russophone et la préserver d’un génocide programmé par Kiev.
49Au milieu de la masse étasunienne, Marignac ne remarque pas les longs métrages français qui, eux aussi, continuent à être distribués. Malgré la guerre, la Russie constitue en effet l’un des principaux marchés d’exportation pour la très morale industrie cinématographique hexagonale. À noter que la Douma a voté en juillet 2025 l’obligation pour les films étrangers d’obtenir auprès du ministère de la Culture un certificat de conformité aux « valeurs spirituelles et morales traditionnelles russes ». À voir si ce dispositif, qui doit entrer en vigueur en janvier 2026, gênera certains films étrangers.
50La famille Mulliez, qui a transféré la gestion de ses magasins à une direction locale en 2023, était en octobre 2024 sur le point de céder ses 230 magasins à un groupe russe. Le projet de vente ne semble pas s’être concrétisé.
51Ivan Nechepurenko, « À Moscou, une fête perpétuelle pour détourner les esprits de la guerre en Ukraine », Courrier international, 13 septembre 2025.
52Voir Mylène Gaulard, « Russie : les secrets de la résilience économique », Hors série, 24 avril 2025.
53Ces zones ne sont probablement pas les plus touristiques mais il faut noter que les restrictions de visas et de liaisons aériennes avec l’Europe a paradoxalement provoqué une importante croissance de l’hôtellerie et de la restauration dans le pays, et une augmentation des salaires de ce secteur. Le nombre des touristes étrangers a considérablement chuté, mais celui des visiteurs en provenance d’Asie, de Turquie ou des pays du Golfe est en forte hausse.
54Sur ces questions, voir Eir Nolsøe et Tim Wallace, « Russia’s new middle class can’t afford for Putin’s war to end », The Telegraph, 24 août 2025, et « Dans trois à cinq ans, la Russie sera méconnaissable », interview de Ekaterina Kurbangaleev par Charlotte Lalanne, L’Express, 7 septembre 2025.
55Si une partie de l’économie de la Russie est orientée vers le conflit en cours, le pays n’est pas pour autant passé en économie de guerre. Cela impliquerait une mobilisation prioritaire des ressources pour l’effort de guerre (au détriment de la consommation civile), des mesures exceptionnelles et des interventions étatiques (réquisitions, rationnement), et une profonde transformation de l’économie « normale » en ce sens (du civil vers le militaire) ; nous n’en sommes pas là, d’autant que la Russie ne consacre que 7 % de son PIB à des dépenses militaires. L’Ukraine y affecte, elle, environ 35 % de son PIB (on peut donc parler d’économie de guerre dans son cas) ; et rappelons que les pays de l’OTAN envisagent d’atteindre les 5 %. D’après Grok, en 1943, l’Allemagne employait environ 75 % de son PIB à l’effort militaire, idem pour l’URSS, plus de 50 % pour la Grande-Bretagne et environ 45 % pour les États-Unis. Ces derniers consacraient 9 % du PIB à la défense au plus fort de la guerre du Vietnam.
56Sur ce sujet, voir Marie Jégo, « La Russie en panne de main-d’œuvre ? », Le Monde, 16 juillet 2025.
57Une récente campagne de l’UE ne soulignait-elle pas que sur Internet, « chacun est libre de s’exprimer, pas de diffuser des contenus illégaux » ?
58Ayant réussi à s’enfuir, elle est aujourd’hui réfugiée en Allemagne mais à tout perdu ; il semble que son fils et sa mère, soutenant Poutine, aient cessé de lui parler.
59Iouri Chevtchouk, leader du fameux groupe de rock DDT, n’a été condamné qu’à 800 € d’amende en août 2022 pour des propos antiguerre tenus lors d’un concert. Le chanteur Vadim Stroykin (bien moins connu), accusé en février 2025 d’avoir fait un don au profit de l’armée ukrainienne, se serait quant à lui défenestré alors que des services de sécurité perquisitionnaient son appartement…
60Voir notre article de mai 2022 sur le site DDT21, « Adieu la vie, adieu l’amour… Ukraine, guerre et auto-organisation ».
61Notamment les sondages du Centre Levada, étiqueté « agent de l’étranger » par le pouvoir et dont les travaux étaient considérés avant guerre comme une référence par les Occidentaux.
62Au début des année 2000, Poutine entame un processus de soumission des oligarques à l’État qui, dès lors, doivent considérablement réduire l’influence politique qu’ils exerçaient sur le pays (certains se sont vu saisir leurs biens et être condamnés à de très lourdes peines de prison).
« Il est pour le moins piquant de constater que le terme “oligarque”, si volontiers appliqué aux magnats russes, trouve curieusement peu d’écho lorsqu’il s’agit de décrire les relations incestueuses entre certains capitaines d’industrie français et le pouvoir politique. Nos célèbres milliardaires sont-ils traités avec moins de déférence par le pouvoir que leurs homologues moscovites ? Les distributions à la volée de Légions d’honneur, les dîners à l’Élysée, les appels téléphoniques directement au ministre concerné lorsqu’un dossier les préoccupe… tout cela ne relève-t-il pas d’une forme d’oligarchie à la française, simplement plus policée, plus feutrée, drapée dans le velours des convenances républicaines ? » Mylène Gaulard, op. cit.
63À cette époque, la presse européenne (bourgeoise ou militante) se focalisait sur les refuzniks russes et la fougue patriotique ukrainienne, refusant de voir les réfractaires et insoumis ukrainiens.
64Voir notre article paru sur le site DDT21 en janvier 2025, « L’Ukraine et ses déserteurs. Partie II : Guerre et révolution ? ».
65Nous avons consacré deux articles aux insoumis et déserteurs ukrainiens disponibles sur le site DDT21.
66Il est par contre vrai que le rapport à la violence et la mort qui existe dans ces régions diffère quelque peu de celui que nous connaissons dans nos contrées.
67S’ils retrouvent la liberté à la suite d’un échange de prisonniers, les soldats ukrainiens ayant subi la captivité peuvent choisir de ne pas retourner au front, ce qu’ils font généralement. Les Russes auraient constaté que les volontaires occidentaux capturés, puis libérés, se retrouvaient à nouveau au combat ; ils auraient donc résolu le problème de cette manière.
68Voir Jules Sergei Fediunin, Les nationalismes russes, Paris, Calmann Lévy, 2024, p.158, 178, 220.
69Anonyme, Poésie par le fait faire. Géographie po(l)étique des avant-gardes de Russie, Z-ditions de l’Amphigouri, 2021, p. 10.
70Thierry Marignac, Des chansons pour les sirènes., Essenine, Tchoudakov, Medvedeva, saltimbanques russes du XXe siècle, Paris, L’Écarlate / Dernier terrain vague, 2012, 176 p.
71Boris Ryjii, La neige couvrira tout, Devesset, Cheyne éditeur, 2020, 96 p. Marignac a traduit plusieurs poèmes de Ryji et les a publiés sur son blog antifixion.blogspot.com.
72Il est toutefois probable que Moscou, ayant eu vent de ce plan si subtil et de ces études, cherche une parade. Un expert économique rappelle d’ailleurs que l’« on pronostique l’épuisement de la machine de guerre russe à l’horizon de dix-huit mois depuis quasiment le début de l’invasion ». Cf. Yves Bourdillon, « L’économie russe s’enlise lentement mais sûrement dans la guerre en Ukraine », Les Échos, 16 septembre 2025.