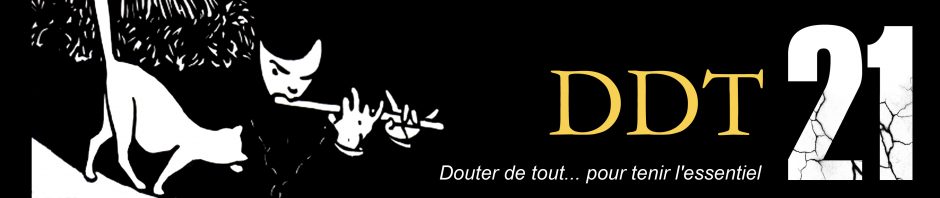La prison a sa mythologie. Celle dont nous allons parler, Rikers, figure dans des séries télévisées et des films comme Carlito’s Way de Brian De Palma (1993). Pour quelques dizaines d’euros, on peut même, en ligne, tenter de s’en évader (un jeu interdit aux moins de 10 ans).
L’enfermement collectif suscite répulsion-attraction pour un monde souvent présenté comme peuplé de gangs ethniques où règne la violence, qu’elle soit exercée par l’institution ou entre les détenus eux-mêmes.
Dans le livre City Time. On Being Sentenced to Rikers Island, un des buts de David Campbell et Jarrod Shanahan (D. & J.) est de réagir contre une vision de l’univers carcéral «concentrée uniquement sur la violence et la prédation » mais qui ignore « les innombrables journées banales d’ennui ordinaire et de gaspillage de potentiel humain qui caractérisent la vie derrière les barreaux pour de nombreuses personnes remarquablement ordinaires ».
L’Île-prison
A peu de distance de Manhattan, sur l’East River, l’île de Rikers (2 km de long sur 1,3 km de large) abrite depuis 1932 la principale prison de la ville et la deuxième plus importante aux États-Unis en nombre de détenus. Le conseil municipal de New York envisage de la fermer, mais elle enferme encore plus de 11 000 personnes, réparties en une dizaine d’établissements différents.
L’un d’eux, ouvert en 1964 et agrandi en 1973, le Eric M. Taylor Center (EMTC) réservé aux hommes et aux mineurs condamnés à ce que l’on appelle City Time, peines inférieures à un an,
peut enfermer environ 3 000 personnes ; la majorité le sont pour des délits non-violents, surtout des vols (d’un montant inférieur à 1 000 dollars), une petite délinquance associée souvent à des problèmes de santé mentale ou de drogue. La moitié d’entre eux restent 30 jours, voire moins, parfois une suite de week-ends.
David Campbell et Jarrod Shanahan ont été, eux, arrêtés pour des raisons directement politiques ; David a été emprisonné à Rickers d’octobre 2019 à octobre 2020 (pour une rixe avec des militants d’extrême droite), Jarrod en juin 2016, « observateurs participants » malgré eux des réalités carcérales.
Enfermer
Les condamnés de type « City Time » ne sont que des ilots du vaste archipel pénal étasunien. On estime à environ 2,3 millions le nombre de détenus aux États-Unis, auxquels s’ajoutent 4,5 millions de personnes en libération conditionnelle (parole) et en liberté surveillée (probation), faisant de ce pays le n° 1 mondial de l’incarcération. [toutes les références à la fin du texte]
Une des principales causes en est la longueur des peines infligées, nettement plus élevée que dans le reste du monde, notamment du fait des peines cumulatives.
Dans l’ensemble des États-Unis, en 2025, selon de Federal Bureau of Prisons, près de la moitié des détenus (43,7 %) le sont pour commerce (voire consommation) de drogue ; 22v% pour détention d’armes et incendie volontaire ; 13,5 % pour délinquance sexuelle ; 4,6 % pour immigration illégale ; 3,4 % pour homicide, « Aggravated Assault » et kidnapping.
En 2018, 2,8 millions d’Américains travaillaient directement dans le secteur « Justice, ordre public et sécurité », soit plus de 1,5 % de l’emploi total (à comparer à moins de 1 % dans l’industrie automobile). Cela sans compter les entreprises en contrat avec les services de police, les tribunaux et les prisons.
Quoique à l’inverse, les pays scandinaves, l’Allemagne et les Pays-Bas aient des taux d’incarcération plus faibles, et même parfois en baisse au cours de la dernière décennie, les États-Unis s’inscrivent dans une tendance mondiale à la hausse.
Au Royaume Uni, le nombre de prisonniers a doublé entre 1993 et 2012, en raison surtout de l’augmentation des comparutions immédiates (immediate custody), des détentions provisoires (remand), et de l’allongement des peines. En 1993, le programme du New Labour se voulait « Sans faiblesse contre le crime, sans faiblesse contre les causes du crime » (« Tough on crime. Tough on the causes of crime »). Ces causes étant à chercher, selon la gauche britannique, non dans des conditions sociales, mais dans le non-respect individuel des bonnes mœurs : les historiens de l’avenir décriront notre temps, malgré les apparences, comme celui d’un grand retour de la morale. Quelques années plus tard, le gouvernement travailliste introduisait l’Anti-Social Behaviour Order permettant de poursuivre toute personne donnant les signes d’un comportement « anti-social », défini selon une gamme assez large pour inclure l’ivresse publique, la mendicité, l’absence de domicile fixe, l’attitude agressive, l’écoute de musique trop forte, la compagnie d’un chien perceptible comme une menace, etc., gestes généralement associés aux basses classes. En conséquence, explique le Prison Reform Trust, la Grande-Bretagne a le taux d’emprisonnement le plus élevé d’Europe occidentale. Sur la longue période, la population carcérale d’Angleterre et du Pays de Galles a quadruplé entre 1900 et 2018, la moitié de l’accroissement ayant eu lieu depuis 1990.
Une société criminalise ce qui perturbe son fonctionnement « normal », les normes variant évidemment selon le pays et l’époque. Autrefois l’un des actes les plus graves, le parricide n’est plus considéré comme tel, alors que le viol conjugal n’a lui une réalité juridique en France que depuis 1990 (1992 en Angleterre)… mais pas en Arabie Saoudite où, par contre, le viol est passible de la peine de mort. Comme indiqué plus haut, la drogue entraîne la moitié des condamnations aux États-Unis. La question, c’est de comprendre ce qui perturbe l’ordre social, et ce qui choque l’opinion publique. Dans une société fondée sur l’exploitation du travail par le capital, il est « normal » de consacrer plus de ressources aux « stups » qu’aux inspecteurs du travail (en France, les accidents du travail causent deux morts chaque jour).
De son côté, la France a alourdi les peines en condamnant plus souvent et pour plus longtemps à la prison, et en élargissant le champ de la pénalisation : par exemple, selon les sources, les infractions routières entraîneraient entre 5 et 12 % des détentions.
Ces statistiques, comme toutes les autres, surtout officielles, ne donnent cependant qu’un ordre de grandeur…. Qui est considéré comme « enfermé »? En France, la « rétention administrative », non comptée comme détention, n’en est pas moins un enfermement. On se gardera aussi de comparaisons qui font apparaître la démocratie étasunienne encore plus répressive que les systèmes pénitentiaire nazi, stalinien, ou chinois actuel… Qui est « en prison » et qui est « au travail» ? « Techniquement », la plupart des Ouïghours soumis aujourd’hui au travail forcé (500 000 ? 1 million ?) ne sont pas des « détenus ».
Par ailleurs, c’est la société qui peut parfois elle-même sans médiation servir de prison : contrôle social informel, par « les voisins vigilants », la pression du conformisme, la surveillance communautaire, l’appel à signaler les contrevenants, et des sites Internet, comme outre-Atlantique, qui dénoncent et harcèlent des détenus libérés après avoir purgé leur peine. Le réformateur bien intentionné ne manque pas de présenter la Suède en « modèle à suivre »: 58 détenus pour 100 000 habitants (103 pour 100 000 en France).
Si nous étions enfermés, probablement préférerions-nous l’être à Norgehaven (Pays-Bas), prison selon Wikipédia « la plus confortable au monde », qu’à Fleury-Mérogis, mais nous savons aussi que le capitalisme ne serait être doux qu’à la marge. La paix sociale ne vaudra jamais pour tout le monde. Pour l’essentiel, la justice « met la transgression (et sa sanction) en spectacle afin de l’évacuer. La prison rassure plus ceux qui n’y iront sans doute pas, qu’elle ne dissuade ceux qui ont des chances d’y aller. » (La Démocratie triomphe à Outreau)
(Sur)vivre
Etre prisonnier, c’est subir dépersonnalisation et réduction de l’autonomie à un minimum, mais aussi, comme le décrivent D. & J., communauté forcée.
A Rikers, les condamnés relevant du City Time ne vivent pas en cellules, mais en vastes dortoirs où, comme les auteurs l’analysent en détail, ils reproduisent un ensemble complexe de rituels et de relations, seul moyen de survivre et de donner un sens au temps qui leur est volé : « En dépit d’une apparence de chaos, la vie sociale du City Time est aussi structurée que ce nous pouvons trouver à peu près partout ailleurs ».
La prison caricature un monde dit libre qui lui impose ses logiques.
Au point que certains petits délinquants en viennent à « considérer leur brève incarcération comme un accident du travail […] Si le vol est une profession, ils constituent ce que nous pourrions appeler son précariat. » (D. & J.)
« Les multiples mésaventures politiques de la guerre contre la drogue et le démantèlement du service de santé ont transformé de fait les prisons et les centres pénitentiaires en services de santé mentale pour les pauvres et en particulier pour les minorités. » (Homer Venters, responsable de la santé à Rikers entre 2008 et 2017) En 2003, un tiers des personnes vivant dans un foyer réservé aux sans-abri avait été interné, on n’ose pas dire hébergé, dans une prison new yorkaise.
Le gang, forme la plus explicite de coopération entre détenus
« Les gangs sont des organisations d’affinité locale, qui ont prospéré depuis le XIXe siècle dans la ville de New York parmi des communautés ouvrières victimes d’une ségrégation ethnique et raciale, aggravée par l’exclusion du marché du travail régulier et bien payé. […] les gangs offrent la promesse d’un statut social, d’argent et de pouvoir grâce à la participation à une économie de marché noir, quoiqu’au risque majeur de perdre sa liberté, voire sa vie. » (D. & J.)
Sans y être omniprésents ni tout-puissants, les gangs n’en sont pas moins au cœur de la vie sociale de Rikers. En 2014, voulant diminuer leur influence et aussi les risques d’agression, l’administration pénitentiaire avait décidé de réunir les membres de chaque gang dans un même dortoir ; elle est revenue sur cette mesure en 2021.
L’existence des gangs a un double effet. D’une part, elle favorise une certaine solidarité, jusqu’à même, on le verra, favoriser une grève des détenus. D’autre part, cette force collective fonctionne au profit de la « bande » elle-même ainsi fortifiée en « proto-État » (D. & J.), qui se justifie comme tout État : « Sans nous, ce serait le chaos ! ». Les membres du gang se réservent la priorité aux meilleurs lits, au choix du programme télé, à l’accès au téléphone, etc. Selon D. & J., chaque dortoir à sa hiérarchie, pas toujours d’ailleurs celle d’un gang organisé dans la prison et à l’extérieur : est « chef » celui qui se donne (ou à qui le groupe reconnaît) une autorité. Parfois contre le racisme des gardiens. Mais il y a aussi des dortoirs « neutres », avec un « leader » auto-désigné, au soft power plus ou moins accepté.
Dans cet entassement de pauvres forcés de vivre ensemble, le collectif impose ses habitudes, ses règles. L’insuffisance d’un repas avalé en un maximum de dix minutes est quelque peu compensée par un échange de nourriture (souvent volée aux cuisines, puisque l’essentiel des services pratiques est assuré par des prisonniers), en contrepartie d’argent, mais parfois aussi offert, quoique, comme dans le monde libre, rien ici ne soit totalement gratuit : le « cadeau » aide le donateur à se construire un « capital social » utile en d’autres occasions.
Collectifs également, le balayage et nettoyage du dortoir, effectués en commun, souvent avec le souci d’efficacité et « un puissant sens du collectif », selon D. & J., alors manifeste en ce moment privilégié.
Avec les gardiens, les détenus vivent sur le mode d’une entente tacite, maintenant « une sorte d’ordre en surface, les apparences extérieures d’une prison gérée en douceur » (D. & J.).
Ainsi qu’il en va dans le monde libre, cela n’exclut pas de revendiquer. Pendant le Covid, comme en beaucoup d’autres lieux, des entreprises en particulier, les détenus au titre de City Time ont fait grève pour exiger d’être protégés (demande de masques, de tests, etc.), et leur revendication a abouti, en particulier grâce au soutien d’une partie des médias. Dans l’unité de David, la grève a été organisée de façon non-hiérarchique, mais dans l’unité voisine, la lutte a été prise en mains par un gang, et sans cet appui, estiment D. & J., l’action aurait certainement été difficile, sinon dangereuse.
Un gang aide à résoudre des conflits. Par exemple, il forcera un perturbateur à changer de dortoir : sorte de bannissement, pas nécessairement violent, par une pression à laquelle s’associe l’ensemble du dortoir.
« Le gang est la forme la plus explicite de coopération entre détenus » (D. & J.) : comme tout contre-pouvoir, il sert de médiateur, de pacificateur, et vit d’un échange de services avec une base, au bénéfice bien sûr d’abord de ses membres.
Surveiller
Beaucoup des gardiens (Correction Officers, « COs » en abrégé) viennent des mêmes milieux, voire des mêmes quartiers, que ceux qu’ils surveillent.
A Rikers, en 2020, parmi les COs, les Blancs composaient 11 % des surveillants, et 8 % des gradés, proportion presque équivalente à celle des détenus. Les Noirs étaient 59 % des surveillants et 74 % des gradés, et les Latinos respectivement 24 % et 14 %.
Si l’on s’éloigne de la métropole multiraciale new yorkaise, dans la prison d’Elmira (à l’ouest de l’État de New York) étudiée par Andrea Morrell en 2008, des gardiens à 97 % Blancs tenaient enfermés des prisonniers entre 60 et 70% de couleur.
Par ailleurs, en 2020, les femmes étaient majoritaires parmi les gardiens (et Noires pour la plupart). Elles subissent un « pacte sexiste contre les femmes » (insultes, harcèlements) de la part de leurs collègues masculins comme des détenus, dont beaucoup n’acceptent pas de de devoir vivre dans une institution « dirigée par des femmes » (D. & J.)
En réaction, les comportements les plus agressifs contre les prisonniers viennent souvent des gardiennes, peut-être, supposent D & J, parce que « les surveillants masculins n’ont tout simplement pas à faire autant d’effort [que leurs collègues féminines] pour que leur autorité soit reconnue. »
Par contre, D. & J. n’ont pas constaté de violences sexuelles, ce qu’ils interprètent ainsi : « Une homophobie généralisée et affirmée, partagée dans toute l’institution par les détenus comme par les gardiens, s’est relativement bien intégrée à un interdit des agressions sexuelles. »
A Rikers, l’identité ethnique ou sexuelle passe après le rôle social et la solidarité créée par le travail. Les COs ont beau avouer « faire un sale boulot » (a dirty job), elles et ils n’en vivent pas moins comme dans « une société à part » (D. & J.), aux intérêts opposés à ceux des détenus.
En témoigne une grève du personnel qui en février 2025 a mobilisé 14.000 gardiens dans 40 des 42 établissements pénitentiaires de l’État de New York. Comme un gréviste s’en plaint à un journaliste, « l’État de New York devient trop laxiste. Il refuse de nous laisser utiliser les moyens à notre disposition. Parfois, [les détenus] sont des gens si mauvais qu’il nous faut les moyens les plus forts. »
« Bien que le COBA [syndicat des surveillants] ait obtenu de substantielles augmentations de salaire et des avantages sociaux pour ses membres, le principal problème qui motive l’activité du syndicat a été la liberté des COs d’utiliser la violence contre les personnes incarcérées comme ils l’entendent, sans surveillance bureaucratique ni enquête indépendante. » (D. & J.)
En fait, explique David, « les gardiens exigent de pouvoir utiliser la force, non seulement comme un moyen pratique, mais comme une sorte de baromètre de leur pouvoir politique », car « la demande d’impunité exprimée par les gardiens renvoie au maintien d’une violence qui est au cœur du système. » (Andrea Morrell)
Sous l’échange d’objets et de services, et le troc, avec les aspects à la fois mesquins et débonnaires du petit commerce, affleurent la contrainte et la violence potentielle sur lesquelles repose le système pénitentiaire.
Si l’on en doutait, dès que les gardiens craignent de perdre le contrôle, l’institution réplique par la force brutale des « tortues ninja », ainsi surnommés pour leur équipement anti-émeute ressemblant à une carapace. En dernier recours, l’État, c’est « une bande d’hommes armés » (Engels).
Travailler
Selon D. & J., si l’on ose une comparaison, le travail à Rikers aurait paradoxalement plus en commun avec le New Deal qu’avec l’esclavage sur une plantation. Il y a là plus de travailleurs que de travail. On ne fabrique ni produit quasiment rien pour l’extérieur : cuisine, nettoyage, etc. la prison « tourne » grâce aux détenus, qui souvent reçoivent un salaire, très inférieur à ce qu’il faudrait payer une main d’œuvre libre. En août 2020, réagissant à une forte baisse des salaires, descendus à 25 cents/heure, les détenus décident un arrêt de travail, et leur grève aboutit à un compromis, défavorable pour la minorité auparavant « bien » payée. Selon les emplois, en octobre 2021, les prisonniers sont payés 55 cents, 1 dollar ou 1,45 dollar de l’heure. Quant à ceux des détenus, une minorité, qui travaillent pour une entreprise privée, ils contribuent au profit de cette entreprise, non directement au système pénitentiaire.
En parallèle, alimenté en partie par ces très maigres revenus, il existe un marché interne : vente de tabac, de téléphones, de drogues, etc., fabrication avec les moyens du bord de plats et de boissons (le cocktail dominicain morir soñando paraît très apprécié), mélange d’échange monétaire et d’échange de services, solidarité mais aussi constitution de ce « capital social » si précieux pour des gens qui n’en ont quasiment pas d’autre.
Pourquoi ?
Dans des pays comme les États-Unis (autre chose est le travail forcé en Chine, par exemple), la société capitaliste moderne est prête (ce que ne faisaient pas les sociétés pré-capitalistes) à dépenser beaucoup pour tenir enfermés ceux qu’elle considère comme des déviants à mettre à l’écart.
En 1911, Emma Goldman notait qu’il en coûtait aux États-Unis un milliard de dollars par an pour entretenir les institutions pénitentiaires, « somme presque aussi importante que la production combinée de blé, évaluée à 750 millions, et de charbon, évaluée à 350 millions ». En 2021, chaque détenu à Rikers coûte en moyenne chaque année 550 000 dollars à la ville de New York (la situation varie beaucoup selon les États et le salaire du personnel pénitentiaire: de 23 000 dollars dans l’Arkansas à plus de 300 000 dans le Massachusetts).
Un demi-million de dollars annuels par prisonnier… chiffre astronomique, « absurde », dira-t-on, et il ne manque pas de critiques pour déplorer que « dans les deux dernières décennies, l’argent dépensé pour les prisons ait augmenté six fois plus vite que celui dépensé pour les universités » (Adam Gopnik). Plutôt que construire des prisons, mieux vaudrait créer des emplois productifs, et investir dans l’école et la formation professionnelle, prévenant ainsi le crime avant qu’il soit commis.
Mais dans quel monde vivons-nous ? On n’a pas attendu notre époque pour s’émouvoir d’une masse de dépossédés potentiellement dangereux : à la fin du XVIIIe siècle, 1 habitant de la France sur 8 aurait été indigent, et on estime qu’il pouvait y avoir à Paris jusqu’à 100 000 mendiants, soit 1 sur 5 ou 6 Parisiens. La nouveauté du capitalisme est de produire sa propre population en surnombre, ensemble de ceux qui ne trouvent pas de place à l’intérieur du rapport capital/travail , chaque pays traitant sa marge et son rebus social selon son histoire et selon ses moyens. Les États-Unis sont un des exemples extrêmes de la tendance générale à l’enfermement, mais une minorité de pays, les Pays-Bas, par exemple, où il est possible de maintenir libres des « exclus du travail » plus ou moins soumis, sont à même de s’offrir une « décroissance carcérale ».
Quelle qu’elle soit, la prison n’a pas à être rentable en termes monétaires. Malgré la tendance à la privatisation, les institutions publiques n’ont pas pour priorité de rapporter de l’argent, et le bilan coût/bénéfice de l’école, de la police et de l’armée n’est pas évaluable en dollars ou en roubles.
Ce qu’elle considère comme crime, la société ne le traite pas pour l’éliminer, mais pour lui donner un prix, réglé non pas en argent, mais en mois et en années d’enfermement. Tant pour un vol de voiture, tant pour un assassinat, sachant que la justice ne pratique pas le prix fixe. Au tribunal, on marchande, il arrive même – rarement – que l’on en sorte sans payer : un procès, c’est le règne de l’aléatoire.
La justice est « moins une manière de résoudre les conflits que de supporter les conflits que l’on n’a pas pu empêcher. Ce faisant, elle les aggrave et en suscite d’autres. Jusqu’à l’absurdité actuelle de la prison criminogène, remède pire que le mal, de l’aveu des humanistes bourgeois les plus éclairés. […] La dénonciation la plus courante de la justice et de la prison présente ces deux institutions comme le visage dur, répressif, dictatorial du capitalisme. La prison serait une institution moyenâgeuse, une survivance des temps barbares. Les policiers seraient la face « fasciste » du capital. En réalité, la prison comme dépotoir social et lieu massif d’exclusion est un phénomène moderne amorcé à l’époque du « grand renfermement » des XVIIe et XVIIIe siècles avec l’Hôpital général, les workhouses, etc. Mais il s’agissait alors d’isoler une population instable jugée dangereuse et de la forcer au travail. Il fallut attendre le XIXe siècle pour que s’épanouisse le système de concentration d’une importante minorité délinquante en un lieu spécifique. Au même titre que l’armée de conscription, le suffrage universel, l’école laïque et obligatoire et la bureaucratie administrative, la justice et la prison modernes sont filles de l’État de l’ère industrielle. […] Police et justice sont chargées de régler leur compte à ceux qui perturbent l’ordre économico-social, de faire le ménage dans les comportements qui dépassent les normes sociales, de punir les meurtres et vols qui n’entrent pas dans le cadre habituel de la société : un accident du travail n’est pas un « meurtre », une fraude fiscale sur des milliards n’est pas forcément un « vol », sauf si un juge inhabituellement scrupuleux s’en mêle. » (« Pour un monde sans innocents », La Banquise, n° 4, 1986)
Aucun groupe humain, aucune société, ne vit sans normes, quelque nom qu’on leur donne et aussi diverses soient-elles. Comment traiter les comportements, les actes qui ne les respectent pas ? Une certitude : la prison est l’une des pires solutions. Qu’en serait-il dans une révolution qui se débarrasserait de l’État, des classes, du rapport capital/travail ? Question fondamentale, plus souvent abordée par les anarchistes que par les marxistes.
David Campbel et Jarrod Shanahan traitent de nombreux aspects de la prison que nous n’avons pu aborder : les visites (remplacées par des rencontres sur vidéo pendant le Covid), les périodes de « vacances », l’alimentation, l’hygiène, le vêtement, les formalités d’entrée et de sortie, la santé, le racisme, etc.
Plus qu’un témoignage : une analyse sociale. Un livre dont on espère vivement la traduction.
G.D., juin 2025
David Campbell, Jarrod Shanahan, City Time. On Being Sentenced to Rikers Island, N.Y. University Press, 2025.
Quelques lectures
Un précédent livre de Jarrod Shanahan analysait déjà Rikers: Captives: How Rikers Island Took New York City Hostage, Verso, 2022.
Un entretien avec David : Charlie Hix, « David Alex Campbell Released From Rikers », Fifth Estate, n° 408, hiver 2021.
Motifs d’incarcération aux États-Unis en 2025.
Prisonniers de la démocratie (3 numéros, 1984-85): le but de ce bulletin, auquel participaient plusieurs animateurs de La Banquise, était de contribuer « dans et hors des prisons [à] un débat entre tous ceux que la société traite en hors-la-loi ou qui, de par leur activité, sont menacés d’être traités comme tels un jour ou l’autre, et qui éprouvent le besoin d’une critique radicale de réalités qui les touchent de près. ».
Numéros disponibles en PDF sur le site Archives autonomies.
Jacob Whiton, In too many American communities, mass incarceration has become a jobs program, 2020.
Prison Reform Trust, Prison. The Facts, 2022.
Adam Gopnik, The Caging of America. Why do We Lock Up so Many People ?
Emma Goldman, « Prisons : A Social Crime & Failure », in Anarchism & Other Essays, , 1911.
Entretien de Jarrod Shanahan avec Andrea R. Morrell sur la grève des gardiens en 2025 : NY’s Prison Guard Strike Has Roots in Decades of Racialized Deindustrialization.
Christian Romon, « Mendiants & policiers à Paris au XVIIIe siècle », Histoire, économie & société, n° 2, 1982, p. 259-295.
Charlie Bauer, Fractures d’une vie, Agone, 2004.
Roger Knobelspiess, QHS, Quartier de haute sécurité [1980], Le Rocher, 2007.
Alexandre Berkman, Mémoires de prison d’un anarchiste, L’Échappée, 2020. Avant-propos d’Hervé Denès, préface de Jacqueline Reuss.
La Banquise, n° 1, 1983, « Pour un monde sans morale ».
La Banquise, n° 4, 1986, « Pour un monde sans innocents » :
Gilles Dauvé, Karl Nesic, La démocratie triomphe à Outreau, 2006.
Note sur l’art abstrait au service de l’enfermement : le damier et les points noir ayant servi à illustrer cet article décoraient une cellule expérimentale de torture psychologique conçue par l’architecte Alphonse Laurencic pour enfermer des « soldats fasciste » durant la guerre d’Espagne… Voir Pat Finn, « The Architecture of Psychological Warfare: How Maddening Modern Art Inspired the Designs of Prison Cells », architizer.com, août 2016.